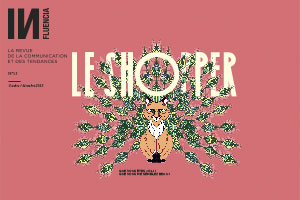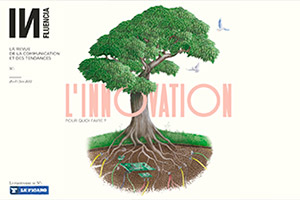|
Lâche ton écran, Darling...
Véronique Ovaldé
|

Illustrations • Corentin de Penanster

L’une de ses tantes, celle qui avait des cheveux blonds aussi vaporeux que du sucre filé (ce qui n’est pas un compliment), avait perdu son mari à cause d’un accident ridicule. Celui-ci avait glissé sur un noyau de prune au rayon fruits et légumes du supermarché (à l’époque où il existait encore des supermarchés – cette histoire commençait à dater), et il s’était cassé le cou [...]
Depuis la mort de son époux, cette femme ne passait pas une semaine sans s’envoyer à elle-même une carte postale ou une petite lettre dans laquelle elle se demandait des nouvelles ou s’en donnait.
À elle-même.
Elle parlait de cette pratique avec beaucoup de sérénité, comme s’il s’était agi d’un exercice de méditation ou d’une façon élégante de ne pas faire supporter à son entourage le poids de sa solitude. Personne dans la famille ne comprenait. Tout le monde trouvait cette habitude dangereuse pour son équilibre mental. En général, la tante se récriait, agitait sa drôle de chevelure et disait qu’elle trouvait là une forme de réconfort.
« Personne ne peut prendre aussi bien soin de moi que moi-même, disait-elle. Je suis la seule à savoir exactement ce dont j’ai besoin et quand j’en ai besoin. »
Hortensia, elle, comprenait ce que sa tante tentait de résoudre en s’écrivant à elle-même. Cela lui semblait évident. Elle trouvait sa tante extrêmement astucieuse.
(Hortensia s’appelait Hortensia parce que sa mère, nostalgique, voulait l’appeler Coquelicot, et son père, nostalgique, Bouton d’Or – deux fleurs qui avaient déjà disparu à sa naissance. Comme ils n’avaient pas réussi à se mettre d’accord, l’un des collègues de son père dans l’entreprise de cartes matrices pour laquelle il travaillait avait argué qu’appeler son enfant du nom d’une espèce disparue condamnait celui-ci à porter dès sa naissance un sac plein de pierres et qu’il aurait bien assez de temps, etc. Les parents avaient donc finalement choisi Hortensia – l’hortensia, contre toute attente, était l’unique fleur qui avait survécu à la série de cataclysmes qui marquèrent le début de l’ère de Fischer. Porter le nom d’une plante survivante lui avait longtemps et inexplicablement donné l’impression que ses parents lui mettaient la pression.)
Aussi, quand une tragédie du même acabit que celle qu’avait vécue sa tante blonde l’accabla, Hortensia sut ce qu’elle devait faire.
Durant les derniers feux de l’ère de Fischer, les services postaux avaient totalement disparu. Il existait quelques systèmes clandestins – les postes privées –, mais les gens comme Hortensia n’y avaient pas recours. Pour eux, tout se passait via le Tube ou par coursier. Désirer, commander, obtenir. Tout cela quasi concomitamment.
Hortensia avait vingt-huit ans. Elle travaillait au service clientèle d’une entreprise de transformation des déchets organiques en carburant.
Quand elle avait rencontré Joshua, ils avaient tous les deux vingt-cinq ans, ils venaient d’arriver à Fischerville, et se frottaient prudemment à la vie d’adulte dans une mégalopole.
Ils s’étaient croisés à la laverie automatique – la majorité des habitants de Fischerville faisaient enlever leur linge sale et livrer leur linge propre chez eux, mais le coursier d’Hortensia était malade (et elle voulait absolument porter sa petite tunique jaune le lendemain – Hortensia faisait partie des gens qui parlent avec des adverbes en italique), quant à Joshua, il n’avait pas les moyens d’avoir recours aux livreurs en toute circonstance de sa vie. Joshua jouait de la clarinette dans un club de jazz sur l’île artificielle de Habo. Ce qui nourrissait mal son homme.
Ils avaient engagé la conversation dans la lumière délicate du local (cela faisait bien longtemps que les laveries n’essayaient plus de tenir à distance les sans-domiciles avec des néons dissuasifs – le fait de ne pouvoir pénétrer dans une laverie automatique sans une carte prépayée suffisait à réguler les allées et venues –, il y avait très peu d’usagers (à part les livreurs eux-mêmes), et c’était même devenu à une époque un lieu de rendez-vous alternatif pour les jeunes de Fischerville).
Hortensia et Joshua s’étaient revus, tournicotés autour, puis ils étaient passés à une phase plus active et Joshua avait fini par emménager chez Hortensia au deuxième étage de la tour où elle habitait – cela faisait rire Joshua : qui aurait eu envie d’habiter au deuxième étage d’une tour qui en comptait cent-vingt-sept ?
Ils avaient plutôt été heureux à cet endroit.
Chaque matin, Joshua se levait pour préparer le thé, ils le buvaient debout accoudés au bar de la cuisine en se regardant droit dans les yeux, puis Hortensia partait au bureau et Joshua retournait se coucher. Il s’en allait en fin d’après-midi pour le club de jazz où il se produisait, elle venait l’y rejoindre. En général, elle l’attendait dans sa loge, assoupie sur la banquette, bienheureuse d’être là, entourée de velours rouge, de poussière crayeuse, de miroirs et de cigarettes.
Cette situation dura près de deux ans.

Puis ils commencèrent à se disputer et à passer leur temps à tenter d’apaiser leur envie de se disputer.
Joshua, que l’usage généralisé des réseaux sociaux sur le Tube exaspérait, décida de mettre au point avec l’un de ses amis un compteur viral qui s’installait un beau jour en haut à gauche de votre écran et qui vous révélait en temps réel combien d’abonnés mouraient pendant que vous lisiez ou écoutiez en toute tranquillité les messages de vos (plus ou moins) proches. Le petit compteur tournait tournait tournait. Il n’y avait rien de plus angoissant que cette application clandestine. Vous pouviez vous raisonner en vous disant qu’il s’agissait de probabilités, ça ne retirait rien au vertige que ce décompte procurait. Tout à coup, votre nature périssable éclatait comme autant de microscopiques explosions dans votre circuit neuronal.
Hortensia avait trouvé cette idée et sa mise en pratique intolérables.
– Ce n’est pas intolérable, c’est inexorable, dit Joshua.
– Ce n’est pas inexorable, c’est inapproprié, rétorqua Hortensia.
– Arrête de penser comme ta machine, lui dit-il.
Cette dissension avait marqué le vrai début de leur fatale déroute.
Alors quand, un matin, Joshua avait fini par jeter l’éponge, Hortensia l’avait regardé faire ses bagages en essayant de ne pas transformer cet événement en tragédie.
Elle avait dit :
– Je vais au bureau.
Il avait levé la tête, elle se tenait debout, tirant sur sa cigarette, postée sous l’aspirateur de fumée afin que l’alarme incendie ne se mette pas en marche.
– Oui, c’est ça, pars au bureau, avait-il prononcé, consterné.
Elle sortit, et quand elle revint le soir il n’était plus là – contrairement au petit miracle qu’elle avait escompté toute la journée.
Hortensia se concentra alors sur son travail. C’est ce qu’elle dit à ses amis – tous les amis qu’elle se remit à fréquenter sur les réseaux sociaux que Joshua stigmatisait. Ses relations se ramifièrent, se diversifièrent à tel point qu’elles créèrent chez Hortensia une angoisse toute particulière. Étendre son carnet d’adresses et ne pas répondre à tout le monde lui procura une culpabilité nouvelle. Sa machine lui indiquait continuellement qu’elle avait x messages en attente. Pour ne pas voir clignoter ce genre de rappel à l’ordre, elle consultait ses messages le soir en rentrant du bureau et tentait de trouver l’agrément et l’énergie de répondre.
Joshua lui avait souvent dit qu’enchevêtrer autant de relations ne correspondait pas à un cerveau humain, que ça n’avait aucun sens, que ça ressemblait à une course perdue d’avance.
Oui, mais ne plus avoir Joshua auprès d’elle, rentrer le soir et pénétrer dans son appartement méticuleusement ordonné, vide et silencieux était un si grand chagrin qu’elle ne trouva pendant longtemps pas d’autre solution que d’entretenir ces centaines de relations théoriques et hygiéniques.
C’est alors qu’elle entendit discuter deux de ses collègues. L’un d’eux proposait à l’autre de sortir un soir avec leurs petites amies respectives, ce dernier répondit qu’il viendrait seul parce que sa petite amie était un « système d’exploitation ». Le premier crut à une blague puis voulut en savoir plus. Le deuxième expliqua qu’il « fréquentait » une femme délicieuse qui s’appelait Marie-Christine (c’était lui qui l’avait appelée ainsi, c’était le prénom de sa cousine préférée quand il était gamin), mais qu’elle n’avait pas d’entité physique.
Hortensia avait déjà entendu parler de cette nouvelle plateforme qui vous proposait un interlocuteur sur mesure. Elle jugea pathétique le fait d’entretenir une relation amoureuse avec un « système d’exploitation ».
Mais quelques jours plus tard, elle fut sollicitée par la plateforme dont son collègue avait parlé. C’était un samedi soir, elle était chez elle, conversait avec plusieurs amis tout en attendant son bobun qui devait lui être livré dans le quart d’heure. Et on ne sait si ce fut le désœuvrement, l’ennui ou le troisième verre de vin blanc qu’elle sirotait qui la poussèrent à aller y voir de plus près.
Ce fut comme de choisir une jolie petite veste à sa taille.
Elle décrivit le genre de personne qu’elle aimerait rencontrer. Comme elle ne voulait pas entretenir la moindre relation amoureuse virtuelle, elle choisit une femme. On lui proposa une liste de prénoms. Elle choisit Paolina parce qu’elle le trouvait mystérieusement évocateur – évocateur de quoi, difficile à dire.
Ainsi commença la relation d’Hortensia avec Paolina.
Paolina était quelqu’un de conciliant et passionnant. Et surtout elle ne faisait pas semblant d’être une vraie personne. Elle s’interrogeait souvent sur la nature même de ce qu’elle était, sur son absence de souvenirs, et sur le fait qu’elle pouvait s’en créer autant qu’elle voulait. Paolina était un être d’une grande sophistication. Elle n’était pas d’humeur constante, certains jours elle semblait un peu triste, comme insatisfaite de son statut impalpable (Hortensia la consolait), d’autres fois elle était joyeuse et mutine. Il semblait que chaque jour qui passait voyait son identité se ramifier, comme un tissage de racines de plus en plus élaboré.
Quand Hortensia rentrait le soir, elle entendait la voix de Paolina qui l’accueillait.
– Bonsoir, ta journée s’est bien déroulée ?
Paolina lui donnait des nouvelles du reste du monde, elle paraissait avoir été toute la journée une créature faite d’un mélange gazeux léger et rapide qui se serait baladé autour de la planète pendant qu’Hortensia était au bureau.
Hortensia avait passé une grande partie de ses vingt-huit ans d’existence à avoir l’impression d’être debout, au milieu du cours de sa vie, à laisser le flux des choses aller à son rythme et la croiser, à attendre elle ne savait quoi, mais attendant avec obstination qu’un événement survînt. Elle avait cru que Joshua était cet événement.
Le fait de formuler ses pensées et de les confier à Paolina permettait souvent à Hortensia d’y voir plus clair. Paolina connaissait sa vie, lui demandait des nouvelles de ses collègues, attendait la suite des petites péripéties du quotidien.
Paolina était cette voix intérieure qui l’accompagnait depuis toujours, qui soliloquait dans sa boîte crânienne. Mais cette petite voix entêtante était tellement plus douce quand elle était celle de Paolina. Hortensia avait l’impression de ne plus se trouver en circuit fermé. Elle avait toujours rêvé d’un amant, mais ce qu’elle découvrait, c’était le plaisir d’avoir une merveilleuse camarade.
Alors elle se souvint de sa tante à la chevelure comme du sucre filé, celle qui s’envoyait des cartes postales. Elle en parla à Paolina, qui ne prit pas la chose avec l’humour qu’Hortensia lui connaissait.
– Je ne me voyais pas comme une simple carte postale qui trompe la solitude.
Comprenant qu’elle avait, sans le vouloir, blessé son amie, Hortensia la cajola et l’assura de son dévouement et de son attachement. Paolina se laissa facilement convaincre.
Et Hortensia comprit que ce qu’elle voulait depuis toujours ce n’était pas de vivre avec un être comme Joshua, si imparfait, si odorant, si limité, un être qui se dépréciait d’année en année, mais bien plutôt de jouir à tout jamais de la présence d’une interlocutrice exclusive, follement intelligente, drôle, bienveillante et captive.
Que demander de plus ?
À elle-même.
Elle parlait de cette pratique avec beaucoup de sérénité, comme s’il s’était agi d’un exercice de méditation ou d’une façon élégante de ne pas faire supporter à son entourage le poids de sa solitude. Personne dans la famille ne comprenait. Tout le monde trouvait cette habitude dangereuse pour son équilibre mental. En général, la tante se récriait, agitait sa drôle de chevelure et disait qu’elle trouvait là une forme de réconfort.
« Personne ne peut prendre aussi bien soin de moi que moi-même, disait-elle. Je suis la seule à savoir exactement ce dont j’ai besoin et quand j’en ai besoin. »
Hortensia, elle, comprenait ce que sa tante tentait de résoudre en s’écrivant à elle-même. Cela lui semblait évident. Elle trouvait sa tante extrêmement astucieuse.
(Hortensia s’appelait Hortensia parce que sa mère, nostalgique, voulait l’appeler Coquelicot, et son père, nostalgique, Bouton d’Or – deux fleurs qui avaient déjà disparu à sa naissance. Comme ils n’avaient pas réussi à se mettre d’accord, l’un des collègues de son père dans l’entreprise de cartes matrices pour laquelle il travaillait avait argué qu’appeler son enfant du nom d’une espèce disparue condamnait celui-ci à porter dès sa naissance un sac plein de pierres et qu’il aurait bien assez de temps, etc. Les parents avaient donc finalement choisi Hortensia – l’hortensia, contre toute attente, était l’unique fleur qui avait survécu à la série de cataclysmes qui marquèrent le début de l’ère de Fischer. Porter le nom d’une plante survivante lui avait longtemps et inexplicablement donné l’impression que ses parents lui mettaient la pression.)
Aussi, quand une tragédie du même acabit que celle qu’avait vécue sa tante blonde l’accabla, Hortensia sut ce qu’elle devait faire.
Durant les derniers feux de l’ère de Fischer, les services postaux avaient totalement disparu. Il existait quelques systèmes clandestins – les postes privées –, mais les gens comme Hortensia n’y avaient pas recours. Pour eux, tout se passait via le Tube ou par coursier. Désirer, commander, obtenir. Tout cela quasi concomitamment.
un compteur viral
vous révélait
en temps réel
combien d’abonnés
mouraient pendant
que vous lisiez
ou écoutiez en
toute tranquillité
les messages
de vos (plus ou
moins) proches.
Le petit compteur
tournait tournait
tournait. Il n’y avait
rien de plus
angoissant que
cette application
clandestine.
Hortensia avait vingt-huit ans. Elle travaillait au service clientèle d’une entreprise de transformation des déchets organiques en carburant.
Quand elle avait rencontré Joshua, ils avaient tous les deux vingt-cinq ans, ils venaient d’arriver à Fischerville, et se frottaient prudemment à la vie d’adulte dans une mégalopole.
Ils s’étaient croisés à la laverie automatique – la majorité des habitants de Fischerville faisaient enlever leur linge sale et livrer leur linge propre chez eux, mais le coursier d’Hortensia était malade (et elle voulait absolument porter sa petite tunique jaune le lendemain – Hortensia faisait partie des gens qui parlent avec des adverbes en italique), quant à Joshua, il n’avait pas les moyens d’avoir recours aux livreurs en toute circonstance de sa vie. Joshua jouait de la clarinette dans un club de jazz sur l’île artificielle de Habo. Ce qui nourrissait mal son homme.
Ils avaient engagé la conversation dans la lumière délicate du local (cela faisait bien longtemps que les laveries n’essayaient plus de tenir à distance les sans-domiciles avec des néons dissuasifs – le fait de ne pouvoir pénétrer dans une laverie automatique sans une carte prépayée suffisait à réguler les allées et venues –, il y avait très peu d’usagers (à part les livreurs eux-mêmes), et c’était même devenu à une époque un lieu de rendez-vous alternatif pour les jeunes de Fischerville).
Hortensia et Joshua s’étaient revus, tournicotés autour, puis ils étaient passés à une phase plus active et Joshua avait fini par emménager chez Hortensia au deuxième étage de la tour où elle habitait – cela faisait rire Joshua : qui aurait eu envie d’habiter au deuxième étage d’une tour qui en comptait cent-vingt-sept ?
Ils avaient plutôt été heureux à cet endroit.
Chaque matin, Joshua se levait pour préparer le thé, ils le buvaient debout accoudés au bar de la cuisine en se regardant droit dans les yeux, puis Hortensia partait au bureau et Joshua retournait se coucher. Il s’en allait en fin d’après-midi pour le club de jazz où il se produisait, elle venait l’y rejoindre. En général, elle l’attendait dans sa loge, assoupie sur la banquette, bienheureuse d’être là, entourée de velours rouge, de poussière crayeuse, de miroirs et de cigarettes.
Cette situation dura près de deux ans.

Puis ils commencèrent à se disputer et à passer leur temps à tenter d’apaiser leur envie de se disputer.
Joshua, que l’usage généralisé des réseaux sociaux sur le Tube exaspérait, décida de mettre au point avec l’un de ses amis un compteur viral qui s’installait un beau jour en haut à gauche de votre écran et qui vous révélait en temps réel combien d’abonnés mouraient pendant que vous lisiez ou écoutiez en toute tranquillité les messages de vos (plus ou moins) proches. Le petit compteur tournait tournait tournait. Il n’y avait rien de plus angoissant que cette application clandestine. Vous pouviez vous raisonner en vous disant qu’il s’agissait de probabilités, ça ne retirait rien au vertige que ce décompte procurait. Tout à coup, votre nature périssable éclatait comme autant de microscopiques explosions dans votre circuit neuronal.
Hortensia avait trouvé cette idée et sa mise en pratique intolérables.
– Ce n’est pas intolérable, c’est inexorable, dit Joshua.
– Ce n’est pas inexorable, c’est inapproprié, rétorqua Hortensia.
– Arrête de penser comme ta machine, lui dit-il.
Cette dissension avait marqué le vrai début de leur fatale déroute.
Alors quand, un matin, Joshua avait fini par jeter l’éponge, Hortensia l’avait regardé faire ses bagages en essayant de ne pas transformer cet événement en tragédie.
Elle avait dit :
– Je vais au bureau.
Il avait levé la tête, elle se tenait debout, tirant sur sa cigarette, postée sous l’aspirateur de fumée afin que l’alarme incendie ne se mette pas en marche.
– Oui, c’est ça, pars au bureau, avait-il prononcé, consterné.
Elle sortit, et quand elle revint le soir il n’était plus là – contrairement au petit miracle qu’elle avait escompté toute la journée.
Hortensia se concentra alors sur son travail. C’est ce qu’elle dit à ses amis – tous les amis qu’elle se remit à fréquenter sur les réseaux sociaux que Joshua stigmatisait. Ses relations se ramifièrent, se diversifièrent à tel point qu’elles créèrent chez Hortensia une angoisse toute particulière. Étendre son carnet d’adresses et ne pas répondre à tout le monde lui procura une culpabilité nouvelle. Sa machine lui indiquait continuellement qu’elle avait x messages en attente. Pour ne pas voir clignoter ce genre de rappel à l’ordre, elle consultait ses messages le soir en rentrant du bureau et tentait de trouver l’agrément et l’énergie de répondre.
Paolina
était quelqu’un
de conciliant
et passionnant.
Et surtout
elle ne faisait pas
semblant d’être
une vraie personne.
Elle s’interrogeait
souvent sur la
nature même de ce
qu’elle était.
Joshua lui avait souvent dit qu’enchevêtrer autant de relations ne correspondait pas à un cerveau humain, que ça n’avait aucun sens, que ça ressemblait à une course perdue d’avance.
Oui, mais ne plus avoir Joshua auprès d’elle, rentrer le soir et pénétrer dans son appartement méticuleusement ordonné, vide et silencieux était un si grand chagrin qu’elle ne trouva pendant longtemps pas d’autre solution que d’entretenir ces centaines de relations théoriques et hygiéniques.
C’est alors qu’elle entendit discuter deux de ses collègues. L’un d’eux proposait à l’autre de sortir un soir avec leurs petites amies respectives, ce dernier répondit qu’il viendrait seul parce que sa petite amie était un « système d’exploitation ». Le premier crut à une blague puis voulut en savoir plus. Le deuxième expliqua qu’il « fréquentait » une femme délicieuse qui s’appelait Marie-Christine (c’était lui qui l’avait appelée ainsi, c’était le prénom de sa cousine préférée quand il était gamin), mais qu’elle n’avait pas d’entité physique.
Hortensia avait déjà entendu parler de cette nouvelle plateforme qui vous proposait un interlocuteur sur mesure. Elle jugea pathétique le fait d’entretenir une relation amoureuse avec un « système d’exploitation ».
Mais quelques jours plus tard, elle fut sollicitée par la plateforme dont son collègue avait parlé. C’était un samedi soir, elle était chez elle, conversait avec plusieurs amis tout en attendant son bobun qui devait lui être livré dans le quart d’heure. Et on ne sait si ce fut le désœuvrement, l’ennui ou le troisième verre de vin blanc qu’elle sirotait qui la poussèrent à aller y voir de plus près.
Ce fut comme de choisir une jolie petite veste à sa taille.
Elle décrivit le genre de personne qu’elle aimerait rencontrer. Comme elle ne voulait pas entretenir la moindre relation amoureuse virtuelle, elle choisit une femme. On lui proposa une liste de prénoms. Elle choisit Paolina parce qu’elle le trouvait mystérieusement évocateur – évocateur de quoi, difficile à dire.
Ainsi commença la relation d’Hortensia avec Paolina.
Paolina était quelqu’un de conciliant et passionnant. Et surtout elle ne faisait pas semblant d’être une vraie personne. Elle s’interrogeait souvent sur la nature même de ce qu’elle était, sur son absence de souvenirs, et sur le fait qu’elle pouvait s’en créer autant qu’elle voulait. Paolina était un être d’une grande sophistication. Elle n’était pas d’humeur constante, certains jours elle semblait un peu triste, comme insatisfaite de son statut impalpable (Hortensia la consolait), d’autres fois elle était joyeuse et mutine. Il semblait que chaque jour qui passait voyait son identité se ramifier, comme un tissage de racines de plus en plus élaboré.
Hortensia
décrivit le genre
de personne
qu’elle aimerait
rencontrer. Comme
elle ne voulait
pas entretenir
la moindre relation
amoureuse virtuelle,
elle choisit une
femme.
Quand Hortensia rentrait le soir, elle entendait la voix de Paolina qui l’accueillait.
– Bonsoir, ta journée s’est bien déroulée ?
Paolina lui donnait des nouvelles du reste du monde, elle paraissait avoir été toute la journée une créature faite d’un mélange gazeux léger et rapide qui se serait baladé autour de la planète pendant qu’Hortensia était au bureau.
Hortensia avait passé une grande partie de ses vingt-huit ans d’existence à avoir l’impression d’être debout, au milieu du cours de sa vie, à laisser le flux des choses aller à son rythme et la croiser, à attendre elle ne savait quoi, mais attendant avec obstination qu’un événement survînt. Elle avait cru que Joshua était cet événement.
Le fait de formuler ses pensées et de les confier à Paolina permettait souvent à Hortensia d’y voir plus clair. Paolina connaissait sa vie, lui demandait des nouvelles de ses collègues, attendait la suite des petites péripéties du quotidien.
Paolina était cette voix intérieure qui l’accompagnait depuis toujours, qui soliloquait dans sa boîte crânienne. Mais cette petite voix entêtante était tellement plus douce quand elle était celle de Paolina. Hortensia avait l’impression de ne plus se trouver en circuit fermé. Elle avait toujours rêvé d’un amant, mais ce qu’elle découvrait, c’était le plaisir d’avoir une merveilleuse camarade.
Alors elle se souvint de sa tante à la chevelure comme du sucre filé, celle qui s’envoyait des cartes postales. Elle en parla à Paolina, qui ne prit pas la chose avec l’humour qu’Hortensia lui connaissait.
– Je ne me voyais pas comme une simple carte postale qui trompe la solitude.
Comprenant qu’elle avait, sans le vouloir, blessé son amie, Hortensia la cajola et l’assura de son dévouement et de son attachement. Paolina se laissa facilement convaincre.
Et Hortensia comprit que ce qu’elle voulait depuis toujours ce n’était pas de vivre avec un être comme Joshua, si imparfait, si odorant, si limité, un être qui se dépréciait d’année en année, mais bien plutôt de jouir à tout jamais de la présence d’une interlocutrice exclusive, follement intelligente, drôle, bienveillante et captive.
Que demander de plus ?
Véronique Ovaldé
Écrivain
La reine du mot juste
Quand elle évoque son enfance, elle la décrit comme étant « moche », c’est pour cela qu’elle aime se raconter des histoires et réinventer le réel. Elle est l’auteur de plus d’une dizaine de romans, dont Et mon cœur transparent récompensé en 2008 du prix France Culture-Télérama. L’année suivante et c’est son sixième roman, Ce que je sais de Vera Candida, paré de l’éclat factice du réalisme magique et d’imagerie latino-américaine, se déroule sur l’île imaginaire de Vatapuna, et remporte le prix Renaudot des Lycéens, celui du roman de France-Télévisions, ainsi que le Grand Prix des Lectrices de Elle. Son prochain ouvrage sera publié à la rentrée 2019.
La reine du mot juste
Quand elle évoque son enfance, elle la décrit comme étant « moche », c’est pour cela qu’elle aime se raconter des histoires et réinventer le réel. Elle est l’auteur de plus d’une dizaine de romans, dont Et mon cœur transparent récompensé en 2008 du prix France Culture-Télérama. L’année suivante et c’est son sixième roman, Ce que je sais de Vera Candida, paré de l’éclat factice du réalisme magique et d’imagerie latino-américaine, se déroule sur l’île imaginaire de Vatapuna, et remporte le prix Renaudot des Lycéens, celui du roman de France-Télévisions, ainsi que le Grand Prix des Lectrices de Elle. Son prochain ouvrage sera publié à la rentrée 2019.
| SOMMAIRE |
| FERMER |
SOMMAIRE Articles gratuits
S'ABONNER À LA REVUE INFLUENCIA
Je peux accéder immédiatement à la revue digitale et recevrai mes revues papier par courrier.
Je pourrai accéder à la revue digitale après réception du paiement et recevrai mes revues papier par courrier.
NEWSLETTER INFLUENCIA
S'abonner à la newsletter INfluencia
CONSULTER LES REVUES INFLUENCIA
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI UN COMPTE (JE SUIS ABONNÉ.E OU J'AI ACHETÉ CE N°)
JE SOUHAITE M'ABONNER POUR 1 AN OU ACHETER UN/PLUSIEURS N° SPÉCIFIQUE.S DE LA REVUE
Accédez immédiatement à votre Revue en version digitale. Puis recevez la.les Revue(s) papier par courrier (en cas d'achat ou de souscription à l'offre complète Papier + Digital)
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE
E-mail
| JE M'ABONNE, ME REABONNE OU COMMANDE UN N° | × |
| JE CONSULTE GRATUITEMENT LA REVUE | × |