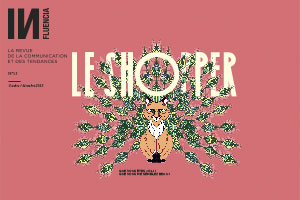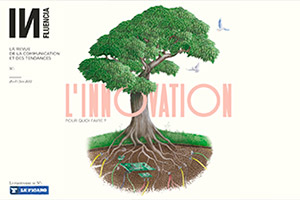|
Faut-il courir aussi vite
que le monde change ?
DANIELLE RAPOPORT
|
Illustrations • Henri Lehamieu

L’ère technologique voit se transformer notre environnement,
mais que cela signifie-t-il pour l’individu ?
Lorsqu’Apollinaire écrit « Sous le pont Mirabeau »,
c’est par le prisme du temps et du corps qu’il mime
sa présence. Ces deux perceptions sont ce que chacun
a de plus intime dans son rapport au monde
et qu’il est urgent de considérer.
L'innovation et le changement vus par Facebook
Si l’on s’en tient dans un premier temps à l’étymologie, transformer, c’est « donner (à une personne ou à une chose) une forme nouvelle », « prendre une autre forme, un autre aspect, une autre manière d’être ».

Cette définition pose la question de l’identité aujourd’hui fort débattue : pérenne ou acquise ? Sujette ou soumise ? Qui devient qui dans le processus continu des transformations tout au long de la vie : restons-nous les mêmes, de quel bricolage identitaire pouvons-nous nous revendiquer au fil du temps, de l’âge, de nos rencontres, de notre environnement, de nos manières de vivre ? De quoi l’autre nous transforme ? Et aujourd’hui, plus encore demain, de quelle nature sera l’impact des (r)évolutions médico-techno-scientifiques, de l’incursion des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives) ? Les avancées exponentielles de l’intelligence artificielle, puces, robots, algorithmes quantiques, influe(ro)nt sur nos rapports au temps, à soi et à l’autre, à notre espérance de vie, notre corps, nos imaginaires et représentations, nos capacités cognitives, nos émotions. Nous traiterons ici des deux aspects, du rapport au temps et au corps.
Longue histoire que celle du temps. Que l’on cherche, en nos temps d’hypermodernité, à maîtriser, à gagner plutôt qu’à perdre dans une logique distributive qui nous échappe, à épouser « agilement » sa fluidité ou fuir les effets délétères de la précipitation dans laquelle nous entraîne l’immensité des stimuli. De prévisible et rassurant, porteur des effets positifs du progrès, le futur, imprévisible et anxiogène, s’est privé d’avenir. Quant au présent, l’usage du temps court, éclaté par les TIC, n’est plus à démontrer, ni l’impatience et la dispersion qui embrouillent nos fonctions cognitives et émotionnelles. Perte en mémorisation, en concentration, en désir de connaissance au profit d’un zapping de savoirs – besoin addictif de s’y abreuver –, gain en rapidité, intuition, et agilité, temps raccourci plutôt que projection d’un long terme possible.
Le temps libéré choisi, maîtrisé, n’est-il que fiction, ne concerne-t-il que ceux qui en ont les possibilités culturelles et matérielles ? Michel Serres rappelle que le gain en espérance de vie se fait au profit (?) d’un temps dévolu à nos écrans. Une nouvelle fracture se dessine, celle des usages qualitatifs du temps. La perception de manquer de temps dénonce le besoin de réponse à la pléthore des stimulations, et aiguise celui d’intensité comme symptôme d’exister.
Les écrans feraient-ils écran à « la vraie vie » ? Rythmes, pauses, lâcher-prises de l’ennui, de la rêverie, du silence – dont nous sommes dépourvus –, alternances, tout cela donnait au temps une saveur particulière. Transformés en piles d’émission et de réception, aspirés plus qu’inspirés par la matrice communicationnelle sans en démêler l’écheveau pour comprendre le monde dans lequel on vit, quel stress ! Faut-il courir aussi vite que le monde change ? À cette injonction et clameur répond la slow attitude, qui veut temporiser les excès/effets du fast et opte pour « marcher au pas de la vache » pour mieux penser. Les recherches du courant transhumaniste interrogent l’espérance de vie, qu’elles projettent en 2100 à 150 ans et bien au-delà. Elles pointent les fantasmes d’hyperpuissance et interrogent la réflexion qui devrait s’engager sur les transformations économiques et sociétales à venir. Quelles relations au travail ? Comment cohabiteront sept ou huit générations ? Quels repères familiaux ? Quel imaginaire autour de la vieillesse, de la mort ? Quid des inégalités aujourd’hui fort probantes, amplifiées ou diluées en fonction d’innovations encore insoupçonnées ? Nous ne sommes qu’à la préhistoire de cette nouvelle histoire du temps qui s’annonce.

Il nous faut interroger les transformations qu’opèrent les nouvelles technologies sur le corps, car c’est là qu’elles s’appliquent le plus distinctement. Le corps, cette rencontre de nos gènes avec l’environnement et nos modes de vie, mêle dans une alchimie systémique ses mécaniques physiologiques, physico-chimiques, psychiques, émotionnelles, cognitives. L’épigénétique nous montre que la génétique n’intervient qu’à « 15 % de ce qui fait fonctionner la machine vivante »1. Les 85 % restants représentent l’influence majeure de nos comportements – alimentation (« nous sommes ce que nous mangeons » ), sport, stress, affects, relations sociales, etc. – et transforment de fait l’empreinte génétique et son expression. Notre corps, cette machine complexe, fonctionne de fait en synergie totale avec le monde extérieur, et dans son expression par l’ADN, n’en est qu’une partie mineure. Cela remet en question et relativise l’importance et le rôle supposés du décodage génétique dans ses potentielles manipulations.
Si les recherches s’orientent vers l’augmentation de nos capacités physiques et mentales – be more humain –, c’est notamment dans un registre de performance quantitative. Plus de puissance, de durée de vie, de mémoire, de santé, cette obsession du « toujours plus » tend à transformer notre corps en une machine entretenue, inventoriée, soignée, appareillée. La prothétisation du corps est déjà présente quand il s’agit de remédier à une vue, une ouïe, des genoux ou des hanches déficientes. Les objets connectés, les nanoparticules, les puces intrusives complètent le tableau démiurgique d’un corps aux mains de la science, qui refuse, dans ces recherches, de le voir souffrir, vieillir, voire mourir. Ces « technologies intrusives posent la question des limites de l’humain et d’une éthique nécessaire à la sauvegarde de son unicité et sa complexité ».2
Qu’en est-il de la médecine connectée et ses appareillages, qui ajoutent à la représentation mécaniste du corps ? D’autant plus performante qu’elle se nourrit de nos profils et nos traces répertoriés par la sciences des datas ? Risque-t-elle de supplanter à terme la pratique des médecins ? Cette super-médecine prédictive et réparatrice rassure et inquiète. Qu’en sera-t-il du soin de soi, des aspects affectifs, émotionnels et intuitifs, que le corps donne à voir et à sentir dans le face-à-face humain avec l’autre, et ici le médecin ? Et de la représentation symbolique du corps et de ses soins ? D’un point de vue plus optimiste, ces deux approches médicales pourront cohabiter dans une complémentarité positive.
L’usage des données et leur appropriation participent aussi à la révolution des représentations du devenir humain. Les fantasmes d’éternelle jeunesse, d’immortalité – les mythes de Faust et du Golem – ont toujours alimenté l’angoisse d’une mort imprévisible, mais certaine. Si l’on en croit les conjectures de Moore [lois empiriques liées à l’évolution de la puissance et la complexité des matériels informatiques, ndlr], les technosciences ont donc un avenir radieux !
Mais quid des inégalités face aux transformations du monde déjà présentes en termes d’espérance et de qualité de vie, et demain confrontées à l’influence positive ou négative de ses propres comportements et son projet d’existence ? Sera-t-il choisi ou subi ? choisi ? Le modèle du « meilleur des mondes »3 est-il une réalité à venir ?
1. Joël de Rosnay.
2. Danielle Rapoport, Les Échos, 22 juin 2016.
3. Aldous Huxley.

Un mouvement perpétuel
Cette définition pose la question de l’identité aujourd’hui fort débattue : pérenne ou acquise ? Sujette ou soumise ? Qui devient qui dans le processus continu des transformations tout au long de la vie : restons-nous les mêmes, de quel bricolage identitaire pouvons-nous nous revendiquer au fil du temps, de l’âge, de nos rencontres, de notre environnement, de nos manières de vivre ? De quoi l’autre nous transforme ? Et aujourd’hui, plus encore demain, de quelle nature sera l’impact des (r)évolutions médico-techno-scientifiques, de l’incursion des NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives) ? Les avancées exponentielles de l’intelligence artificielle, puces, robots, algorithmes quantiques, influe(ro)nt sur nos rapports au temps, à soi et à l’autre, à notre espérance de vie, notre corps, nos imaginaires et représentations, nos capacités cognitives, nos émotions. Nous traiterons ici des deux aspects, du rapport au temps et au corps.
UNE NOUVELLE FRACTURE
SE DESSINE, CELLE DES USAGES
QUALITATIFS DU TEMPS.
Le temps enfoui
Longue histoire que celle du temps. Que l’on cherche, en nos temps d’hypermodernité, à maîtriser, à gagner plutôt qu’à perdre dans une logique distributive qui nous échappe, à épouser « agilement » sa fluidité ou fuir les effets délétères de la précipitation dans laquelle nous entraîne l’immensité des stimuli. De prévisible et rassurant, porteur des effets positifs du progrès, le futur, imprévisible et anxiogène, s’est privé d’avenir. Quant au présent, l’usage du temps court, éclaté par les TIC, n’est plus à démontrer, ni l’impatience et la dispersion qui embrouillent nos fonctions cognitives et émotionnelles. Perte en mémorisation, en concentration, en désir de connaissance au profit d’un zapping de savoirs – besoin addictif de s’y abreuver –, gain en rapidité, intuition, et agilité, temps raccourci plutôt que projection d’un long terme possible.
Le temps libéré choisi, maîtrisé, n’est-il que fiction, ne concerne-t-il que ceux qui en ont les possibilités culturelles et matérielles ? Michel Serres rappelle que le gain en espérance de vie se fait au profit (?) d’un temps dévolu à nos écrans. Une nouvelle fracture se dessine, celle des usages qualitatifs du temps. La perception de manquer de temps dénonce le besoin de réponse à la pléthore des stimulations, et aiguise celui d’intensité comme symptôme d’exister.
SI LES RECHERCHES
S’ORIENTENT VERS
L’AUGMENTATION DE NOS
CAPACITÉS, C’EST DANS
UN REGISTRE
DE PERFORMANCE
QUANTITATIVE.
Le rythme et la durée
Les écrans feraient-ils écran à « la vraie vie » ? Rythmes, pauses, lâcher-prises de l’ennui, de la rêverie, du silence – dont nous sommes dépourvus –, alternances, tout cela donnait au temps une saveur particulière. Transformés en piles d’émission et de réception, aspirés plus qu’inspirés par la matrice communicationnelle sans en démêler l’écheveau pour comprendre le monde dans lequel on vit, quel stress ! Faut-il courir aussi vite que le monde change ? À cette injonction et clameur répond la slow attitude, qui veut temporiser les excès/effets du fast et opte pour « marcher au pas de la vache » pour mieux penser. Les recherches du courant transhumaniste interrogent l’espérance de vie, qu’elles projettent en 2100 à 150 ans et bien au-delà. Elles pointent les fantasmes d’hyperpuissance et interrogent la réflexion qui devrait s’engager sur les transformations économiques et sociétales à venir. Quelles relations au travail ? Comment cohabiteront sept ou huit générations ? Quels repères familiaux ? Quel imaginaire autour de la vieillesse, de la mort ? Quid des inégalités aujourd’hui fort probantes, amplifiées ou diluées en fonction d’innovations encore insoupçonnées ? Nous ne sommes qu’à la préhistoire de cette nouvelle histoire du temps qui s’annonce.

Le corps sous influences
Il nous faut interroger les transformations qu’opèrent les nouvelles technologies sur le corps, car c’est là qu’elles s’appliquent le plus distinctement. Le corps, cette rencontre de nos gènes avec l’environnement et nos modes de vie, mêle dans une alchimie systémique ses mécaniques physiologiques, physico-chimiques, psychiques, émotionnelles, cognitives. L’épigénétique nous montre que la génétique n’intervient qu’à « 15 % de ce qui fait fonctionner la machine vivante »1. Les 85 % restants représentent l’influence majeure de nos comportements – alimentation (« nous sommes ce que nous mangeons » ), sport, stress, affects, relations sociales, etc. – et transforment de fait l’empreinte génétique et son expression. Notre corps, cette machine complexe, fonctionne de fait en synergie totale avec le monde extérieur, et dans son expression par l’ADN, n’en est qu’une partie mineure. Cela remet en question et relativise l’importance et le rôle supposés du décodage génétique dans ses potentielles manipulations.
Si les recherches s’orientent vers l’augmentation de nos capacités physiques et mentales – be more humain –, c’est notamment dans un registre de performance quantitative. Plus de puissance, de durée de vie, de mémoire, de santé, cette obsession du « toujours plus » tend à transformer notre corps en une machine entretenue, inventoriée, soignée, appareillée. La prothétisation du corps est déjà présente quand il s’agit de remédier à une vue, une ouïe, des genoux ou des hanches déficientes. Les objets connectés, les nanoparticules, les puces intrusives complètent le tableau démiurgique d’un corps aux mains de la science, qui refuse, dans ces recherches, de le voir souffrir, vieillir, voire mourir. Ces « technologies intrusives posent la question des limites de l’humain et d’une éthique nécessaire à la sauvegarde de son unicité et sa complexité ».2
Le devenir humain
Qu’en est-il de la médecine connectée et ses appareillages, qui ajoutent à la représentation mécaniste du corps ? D’autant plus performante qu’elle se nourrit de nos profils et nos traces répertoriés par la sciences des datas ? Risque-t-elle de supplanter à terme la pratique des médecins ? Cette super-médecine prédictive et réparatrice rassure et inquiète. Qu’en sera-t-il du soin de soi, des aspects affectifs, émotionnels et intuitifs, que le corps donne à voir et à sentir dans le face-à-face humain avec l’autre, et ici le médecin ? Et de la représentation symbolique du corps et de ses soins ? D’un point de vue plus optimiste, ces deux approches médicales pourront cohabiter dans une complémentarité positive.
L’usage des données et leur appropriation participent aussi à la révolution des représentations du devenir humain. Les fantasmes d’éternelle jeunesse, d’immortalité – les mythes de Faust et du Golem – ont toujours alimenté l’angoisse d’une mort imprévisible, mais certaine. Si l’on en croit les conjectures de Moore [lois empiriques liées à l’évolution de la puissance et la complexité des matériels informatiques, ndlr], les technosciences ont donc un avenir radieux !
Mais quid des inégalités face aux transformations du monde déjà présentes en termes d’espérance et de qualité de vie, et demain confrontées à l’influence positive ou négative de ses propres comportements et son projet d’existence ? Sera-t-il choisi ou subi ? choisi ? Le modèle du « meilleur des mondes »3 est-il une réalité à venir ?
1. Joël de Rosnay.
2. Danielle Rapoport, Les Échos, 22 juin 2016.
3. Aldous Huxley.
Danielle Rapoport
Psychologue, consultante en innovation stratégique, elle étudie les modes de vie et les problématiques du changement (crise, vieillissement, environnement, ados). Directrice du cabinet DRC, ses clients sont des institutionnels, des grands groupes et des PME.
| SOMMAIRE |
| FERMER |
SOMMAIRE Articles gratuits
S'ABONNER À LA REVUE INFLUENCIA
Je peux accéder immédiatement à la revue digitale et recevrai mes revues papier par courrier.
Je pourrai accéder à la revue digitale après réception du paiement et recevrai mes revues papier par courrier.
NEWSLETTER INFLUENCIA
S'abonner à la newsletter INfluencia
CONSULTER LES REVUES INFLUENCIA
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI UN COMPTE (JE SUIS ABONNÉ.E OU J'AI ACHETÉ CE N°)
JE SOUHAITE M'ABONNER POUR 1 AN OU ACHETER UN/PLUSIEURS N° SPÉCIFIQUE.S DE LA REVUE
Accédez immédiatement à votre Revue en version digitale. Puis recevez la.les Revue(s) papier par courrier (en cas d'achat ou de souscription à l'offre complète Papier + Digital)
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE
E-mail
| JE M'ABONNE, ME REABONNE OU COMMANDE UN N° | × |
| JE CONSULTE GRATUITEMENT LA REVUE | × |