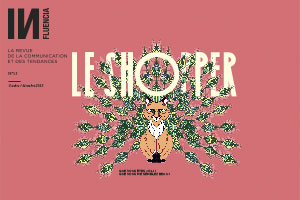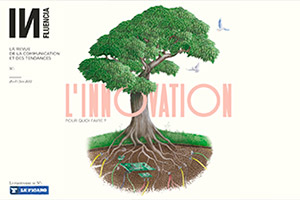|
PETIT ÉLOGE
DE LA RÊVERIE
MICHAËL DANDRIEUX
|
Illustrations • Henri Lemahieu
CONTRE TOUTE IMMOBILITÉ,
À REBOURS DES CYCLES
ET DU TEMPS LINÉAIRE,
CONTRE LE PRÉDICTIBLE,
POUR TORDRE LES PLANS
ET LES CARTES…
LAISSER VENIR EN SOI
LES INTERFÉRENCES QUI FONT
LA SÈVE DE LA VIE,
S’ABANDONNER AUPRÈS
DES FAUNES ET DES MUSES :
DE L’IMPORTANCE DE RÊVER
DANS NOS SOCIÉTÉS
DE L’ENNUI.
Nous convoitons les objets des séries industrielles et la sécurité des chaînes de causes parce qu’on les sait reproductibles. Mais rien de ce qui se répète ne peut être précieux ! Fort heureusement, nous ne rêvons jamais deux fois le même rêve.
Pour la veille (la phrase est de Weber), « nous croyons qu’à chaque instant nous pourrions, pourvu seulement que nous le voulions, nous prouver qu’il n’existe en principe aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère dans le cours de la vie ; bref que nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision ». Mais par une vie dont tout nous est connu, on ne peut pas être surpris. Plus rien n’y est possible, puisque tout est certain. Là, toute la vie symbolique deviendra maigre. La vie symbolique, qui se nourrit de l’ambiguïté, de la pluralité de l’être, perd de sa vigueur dès lors que nous nous affairons à démagifier le paysage qui nous entoure, à le réduire à nos séries et à nos causes, à le priver de sa sauvagerie.
C’est de manière très opportune que le rêve vient réensauvager le monde ordonné de l’homme moderne. Y mettre un peu de panique. Le citadin qui convoite la répétition du même, l’identité des choses. Tout ce qui ne change pas occupe chez lui le haut du panthéon des valeurs : les idéaux des trois derniers siècles (de Laplace aux Big data) fouillent dans le présent, cherchent le rythme qui prédira l’avenir. Seuls le jour et son règne des choses claires semblent être dignes de son temps.
Le rêve, tout à l’opposé, ramène la possibilité de la transformation. Il y a quelque chose d’intranquille dans la nuit, une agitation touchant même les formes stables que, le jour, nous considérons comme données. Rien n’est donné dans le rêve. Les heures éveillées que nous passons à organiser la vie dans le « système des caissettes » (Jung), le rêve les détisse assidûment, comme s’il était une fonction de l’être vouée à ce que nous ne nous sentions pas trop possesseurs, ou propriétaires de rien.
Que cherche l’homme dans ses activités ? Tennyson s’est posé la question dans un poème. Il dit que l’âme n’aspire pas à la propriété. Elle n’aspire ni à la vacance de « l’île aux bénis », ni au confort du « siège des justes ». Elle ne veut pas atteindre, une fois pour toutes, l’état de la tranquillité. Au contraire, ce qu’elle souhaite, c’est « la récompense de poursuivre et non de mourir ».
« Ce qu’elle souhaite, c’est qu’on lui permette de continuer », de saisir à pleines mains le « qui-vive ». Ce « cou tendu » de la créature qu’est la vie (Buber). Dans le repos de toutes les activités flottent l’image funeste, le corps de la bête morte, le repos qui menace de s’éterniser. Ce que cherche l’homme dans ses activités, c’est l’activité elle-même : la vie qui est dans l’acte, si l’on joue sur les mots.
On a contenu le citadin dans le couplet des stations et des transits. Tenez-vous immobile dans une rue de Londres et vous serez l’objet de toutes les suspicions. Qui n’a pas de destination ? Que dire de celui qui ne sait où il va ? Si personne ne l’attend, quelle méchanceté solitaire laissera-t-il grandir en lui ? Il faudrait toujours circuler, d’un point de la carte à un autre.
C’est comme s’il fallait avoir un plan avant toute balade : avant l’école buissonnière, avant la dissertation, avant toute découverte scientifique. C’est le contraire qui est vrai. Tous ceux qui ont entamé une recherche l’ont senti. Une recherche véritable est par essence un abandon du règne des vecteurs, des habitudes de la cartographie. On ne va pas d’un point à un autre : on tourne plusieurs fois en rond (re-circa). C’est ce qui enrageait le journaliste, dans les années 1960 : « Mais quand vous cherchez à résoudre un problème théorique, quand vous cherchez à dégager une loi, vous savez d’où vous partez, vous savez où vous voulez aller ! », à qui Lichnerowicz, le mathématicien, rétorquait : « Non. Non. Je vais où je peux. Et soit je me cogne à la matière, au réel physique, soit à ma propre sottise, soit au fonctionnement de l’esprit. Mais je me cogne toujours. »
Ce heurt avec l’imprévu, c’est la création. Mais nous, nous sommes persuadés que la plus grande merveille de ce monde se trouve dans sa régularité, à tel point que, dans ce qui se déroule contrairement à nos prédictions, le don de l’aventure nous échappe. Tout au mieux accueillons-nous le désordre avec appréhension.

Pour ne pas s’y tromper, les Grecs avaient réparti les rêves en deux catégories : ceux qui apportent une prédiction du futur qui sera réalisée, et ceux dont le contenu n’a de rapport avec rien de connu, ceux qui ne se réaliseront pas. Mais ils pensaient que le rêve le plus riche n’est pas celui qui prédit le futur, une idée qui peut nous sembler étrangère. Pourtant : que le rêve nous raconte un événement qui ne se produira pas, et voilà le trésor de l’imagination, la pure invention de l’esprit !
Cette inspiration, on ne peut pas la forcer. Encore Weber, il y a cent ans : l’inspiration est quelque chose qui doit « venir à l’esprit » du travailleur. Lorsqu’elle est représentée dans les mythes, elle revêt des atours magiques. Les muses qui engendrent l’enthousiasme, chantent et se présentent dans la grâce. La théopneusie veut que la Bible tout entière ait été soufflée par le Saint- Esprit.
Dans la mythologie scandinave, l’hydromel poétique accorde à celui qui le boit le talent du conteur. Nulle part il n’est dit que l’inspiration vienne sous la forme d’une grammaire ou d’une grille. Les conditions propices au souffle créateur ont une essence partagée avec l’essence de la nuit : une capacité de mélange, une perspective estompée, l’éloignement de cette forme de lumière qui vient dépouiller les mystères. Elle vient par le chant, la métaphore, l’ivresse.
Le rêve est de ces sources. On ne le partage pas : sa valeur est incertifiable. On ne le démontre pas : il est irreproductible. Le rêve est l’argument du fourmillement. C’est par lui que nous nous souvenons de la mobilité du monde, du lent déplacement tectonique des matières que notre empressement juge mortes. Par le rêve nous éprouvons le renouvellement permanent des formes de la vie. Il est le souvenir, parmi les institutions du béton, que tout coule.
*Auteur de Le rêve et la métaphore. Sources et structures du lien social. CNRS Editions, 2016.

Pour la veille (la phrase est de Weber), « nous croyons qu’à chaque instant nous pourrions, pourvu seulement que nous le voulions, nous prouver qu’il n’existe en principe aucune puissance mystérieuse et imprévisible qui interfère dans le cours de la vie ; bref que nous pouvons maîtriser toute chose par la prévision ». Mais par une vie dont tout nous est connu, on ne peut pas être surpris. Plus rien n’y est possible, puisque tout est certain. Là, toute la vie symbolique deviendra maigre. La vie symbolique, qui se nourrit de l’ambiguïté, de la pluralité de l’être, perd de sa vigueur dès lors que nous nous affairons à démagifier le paysage qui nous entoure, à le réduire à nos séries et à nos causes, à le priver de sa sauvagerie.
Le rêve ramène
la possibilité
de la
transformation.
Il y a quelque
chose
d’intranquille
dans la nuit.
RÉENSAUVAGEMENT
C’est de manière très opportune que le rêve vient réensauvager le monde ordonné de l’homme moderne. Y mettre un peu de panique. Le citadin qui convoite la répétition du même, l’identité des choses. Tout ce qui ne change pas occupe chez lui le haut du panthéon des valeurs : les idéaux des trois derniers siècles (de Laplace aux Big data) fouillent dans le présent, cherchent le rythme qui prédira l’avenir. Seuls le jour et son règne des choses claires semblent être dignes de son temps.
Le rêve, tout à l’opposé, ramène la possibilité de la transformation. Il y a quelque chose d’intranquille dans la nuit, une agitation touchant même les formes stables que, le jour, nous considérons comme données. Rien n’est donné dans le rêve. Les heures éveillées que nous passons à organiser la vie dans le « système des caissettes » (Jung), le rêve les détisse assidûment, comme s’il était une fonction de l’être vouée à ce que nous ne nous sentions pas trop possesseurs, ou propriétaires de rien.
Que cherche l’homme dans ses activités ? Tennyson s’est posé la question dans un poème. Il dit que l’âme n’aspire pas à la propriété. Elle n’aspire ni à la vacance de « l’île aux bénis », ni au confort du « siège des justes ». Elle ne veut pas atteindre, une fois pour toutes, l’état de la tranquillité. Au contraire, ce qu’elle souhaite, c’est « la récompense de poursuivre et non de mourir ».
« Ce qu’elle souhaite, c’est qu’on lui permette de continuer », de saisir à pleines mains le « qui-vive ». Ce « cou tendu » de la créature qu’est la vie (Buber). Dans le repos de toutes les activités flottent l’image funeste, le corps de la bête morte, le repos qui menace de s’éterniser. Ce que cherche l’homme dans ses activités, c’est l’activité elle-même : la vie qui est dans l’acte, si l’on joue sur les mots.
Ce que cherche l’homme
dans ses activités, c’est l’activité elle-même : la vie qui
est dans l’acte.
FLÂNERIES
On a contenu le citadin dans le couplet des stations et des transits. Tenez-vous immobile dans une rue de Londres et vous serez l’objet de toutes les suspicions. Qui n’a pas de destination ? Que dire de celui qui ne sait où il va ? Si personne ne l’attend, quelle méchanceté solitaire laissera-t-il grandir en lui ? Il faudrait toujours circuler, d’un point de la carte à un autre.
C’est comme s’il fallait avoir un plan avant toute balade : avant l’école buissonnière, avant la dissertation, avant toute découverte scientifique. C’est le contraire qui est vrai. Tous ceux qui ont entamé une recherche l’ont senti. Une recherche véritable est par essence un abandon du règne des vecteurs, des habitudes de la cartographie. On ne va pas d’un point à un autre : on tourne plusieurs fois en rond (re-circa). C’est ce qui enrageait le journaliste, dans les années 1960 : « Mais quand vous cherchez à résoudre un problème théorique, quand vous cherchez à dégager une loi, vous savez d’où vous partez, vous savez où vous voulez aller ! », à qui Lichnerowicz, le mathématicien, rétorquait : « Non. Non. Je vais où je peux. Et soit je me cogne à la matière, au réel physique, soit à ma propre sottise, soit au fonctionnement de l’esprit. Mais je me cogne toujours. »
Ce heurt avec l’imprévu, c’est la création. Mais nous, nous sommes persuadés que la plus grande merveille de ce monde se trouve dans sa régularité, à tel point que, dans ce qui se déroule contrairement à nos prédictions, le don de l’aventure nous échappe. Tout au mieux accueillons-nous le désordre avec appréhension.

CE QUI « VIENT À L’ESPRIT »
Pour ne pas s’y tromper, les Grecs avaient réparti les rêves en deux catégories : ceux qui apportent une prédiction du futur qui sera réalisée, et ceux dont le contenu n’a de rapport avec rien de connu, ceux qui ne se réaliseront pas. Mais ils pensaient que le rêve le plus riche n’est pas celui qui prédit le futur, une idée qui peut nous sembler étrangère. Pourtant : que le rêve nous raconte un événement qui ne se produira pas, et voilà le trésor de l’imagination, la pure invention de l’esprit !
Cette inspiration, on ne peut pas la forcer. Encore Weber, il y a cent ans : l’inspiration est quelque chose qui doit « venir à l’esprit » du travailleur. Lorsqu’elle est représentée dans les mythes, elle revêt des atours magiques. Les muses qui engendrent l’enthousiasme, chantent et se présentent dans la grâce. La théopneusie veut que la Bible tout entière ait été soufflée par le Saint- Esprit.
Dans la mythologie scandinave, l’hydromel poétique accorde à celui qui le boit le talent du conteur. Nulle part il n’est dit que l’inspiration vienne sous la forme d’une grammaire ou d’une grille. Les conditions propices au souffle créateur ont une essence partagée avec l’essence de la nuit : une capacité de mélange, une perspective estompée, l’éloignement de cette forme de lumière qui vient dépouiller les mystères. Elle vient par le chant, la métaphore, l’ivresse.
Le rêve est de ces sources. On ne le partage pas : sa valeur est incertifiable. On ne le démontre pas : il est irreproductible. Le rêve est l’argument du fourmillement. C’est par lui que nous nous souvenons de la mobilité du monde, du lent déplacement tectonique des matières que notre empressement juge mortes. Par le rêve nous éprouvons le renouvellement permanent des formes de la vie. Il est le souvenir, parmi les institutions du béton, que tout coule.
*Auteur de Le rêve et la métaphore. Sources et structures du lien social. CNRS Editions, 2016.
MICHAËL DANDRIEUX
Il est sociologue, de la tradition de la sociologie de l’imaginaire. Il est le cofondateur de la société d’étude Eranos, le directeur de la stratégie de Hands Agency et le directeur éditorial des Cahiers européens de l’imaginaire. En 2016, il a publié Le rêve et la métaphore (CNRS Éditions).

| SOMMAIRE |
| FERMER |
SOMMAIRE Articles gratuits
S'ABONNER À LA REVUE INFLUENCIA
Je peux accéder immédiatement à la revue digitale et recevrai mes revues papier par courrier.
Je pourrai accéder à la revue digitale après réception du paiement et recevrai mes revues papier par courrier.
NEWSLETTER INFLUENCIA
S'abonner à la newsletter INfluencia
CONSULTER LES REVUES INFLUENCIA
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI UN COMPTE (JE SUIS ABONNÉ.E OU J'AI ACHETÉ CE N°)
JE SOUHAITE M'ABONNER POUR 1 AN OU ACHETER UN/PLUSIEURS N° SPÉCIFIQUE.S DE LA REVUE
Accédez immédiatement à votre Revue en version digitale. Puis recevez la.les Revue(s) papier par courrier (en cas d'achat ou de souscription à l'offre complète Papier + Digital)
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE
E-mail
| JE M'ABONNE, ME REABONNE OU COMMANDE UN N° | × |
| JE CONSULTE GRATUITEMENT LA REVUE | × |