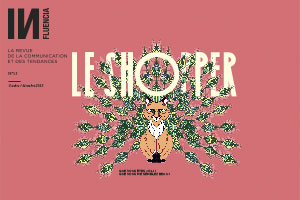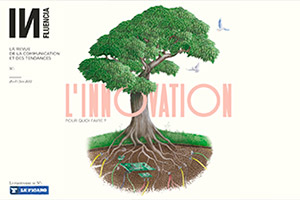|
FEMMES
À LA CONQUÊTE
D’ELLES-MÊMES
cristina alonso
|

Illustrations • Étienne Delatour
L’histoire des femmes est une tragédie
qu’elles ont su transformer en une conquête de tous les instants,
portée par de grandes figures d’hier et d’aujourd’hui.
Et si elle est loin d’être gagnée, il y a cependant de fortes chances
pour que les femmes ne se taisent plus jamais.
2019. Des sportives qui pleurent, jettent leur veste à terre, hurlent toutes veines au vent, frappent violemment les raquettes à la terre, sautent en l’air, défont de rage le bandeau qui noue leurs cheveux, sortent de leurs gonds pour interpeller un arbitre qui ne les écoute pas. Une voix off, celle de Serena Williams pèse sur ces images. En regrettant que les hommes les traitent d’hystériques, d’instables, de filles peu fiables, d’idiotes… et enfin de folles dès qu’elles sortent du rang. Il s’agit du dernier spot Nike : « Dream Crazier ».
Et ce manifeste de l’agence américaine Chiat Day lancé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes résume à lui seul la condition féminine depuis que le monde est monde. Elles doivent tenir leur langue, ou se taire, demeurer sous le joug de l’homme, ou obéir à une image qui selon les époques varie. Enfin… pas tant que cela. Femme, ouvrez la bouche en place publique au Moyen Âge et vous êtes une sorcière qu’il faut brûler ; soyez artiste, musicienne au xixe siècle, et vous êtes une malade mentale qu’il convient d’interner ; soyez veuve et sans ressources, vous atterrissez à l’hôpital de la Salpêtrière ; ayez des symptômes dépressifs et c’en est fini de votre sexualité. C’est ainsi.
« Cette culture de la folie est reliée aux rôles de genre, aux conditions sociales et à une conception beaucoup plus large du désordre. D’un point de vue culturel, la folie dépend également d’une association toute faite entre nature et féminité. Si, dans notre système symbolique, les hommes sont culturellement associés à la raison, à l’esprit scientifique et à la logique, les femmes sont plutôt liées à l’émotif, au chaos, au désordre des sens. Dans cette lignée, le concept de folie échoue donc tout naturellement (ou plutôt tout “culturellement”) aux femmes », comme l’explique l’Américaine écrivaine féministe Elaine Showalter dans The Madness Malady, ouvrage publié en 1985 qui étudie l’étroitesse du lien entre genre et folie au cœur de l’Angleterre du xviiie siècle. Plus proche de nous, en France : « Chaque année, à l’hospice de la Salpêtrière, un bal est organisé le jour de la Mi-Carême pour la plus grande joie des pauvres folles, pensionnaires de cet établissement », écrivait Le Petit Parisien en ce 17 mars 1887, poursuivant quelques lignes plus loin, « quand on se rappelle que dans le même hospice de la Salpêtrière, où l’on dansait si joyeusement hier, les pauvres folles étaient encore il n’y a pas quatre-vingts ans enfermées à demi-nues, le corps chargé de chaînes et de carcans, dans des loges souterraines où “elles avaient souvent les pieds rongés par les rats” ou gelés “par le froid des hivers”, on songe non sans fierté au chemin parcouru, et l’on se dit que ni la science, ni la philanthropie, ni le progrès ne sont de vains mots… » Des internements continuels et sans réelle raison, si ce n’est la différence… Yannick Ripa, historienne française, relate dans L’Affaire Rouy. Une femme contre l’asile au xixe (éd. Tallandier, 2010), l’histoire de Hersilie Rouy, une musicienne internée arbitrairement en asile qui réussit à en sortir et se lança dès lors dans un combat contre les internements psychiatriques abusifs.

Et, de fait, par une sorte de raccourci intellectuel, social et politique, les femmes sont ontologiquement folles… et représentent littéralement la déraison et le déséquilibre. Le bassin imaginaire de la folie est donc inévitablement genré : il s’oppose en négatif au rationnel masculin. Cette séparation symbolique entre les genres dépend essentiellement d’une conception culturelle du délire que représente le « caractère féminin » aux yeux de l’organisation patriarcale. Pour preuve ? Le lexique encore d’usage aujourd’hui : une femme « pique des crises de nerfs », « se fait tout un cinéma », est « folle à lier », hystérique, perd la tête ou la raison, « est une mégère », et « si énervée, c’est donc qu’elle a ses règles ». En un mot comme en cent, les femmes sont soumises à leurs hormones, et à leurs émotions.
Forts de ce constat, il nous suffit d’observer l’évolution de la société pour comprendre. Le milieu du sport en est l’un des meilleurs exemples. Aujourd’hui encore les jeunes filles doivent se battre pour faire de la boxe, du vélo, de la capoeira, « en attendant “de faire un vrai métier”, comme le leur disent leurs parents », explique Marie-Françoise Potereau directrice de Femix’Sports (lire page 113), « et c’est seulement en janvier 2013 qu’un guide juridique relatif à la prévention et lutte contre les incivilités, violences et discriminations dans le sport a été diffusé par le MSJEPVA aux acteurs du sport ». Autant dire hier. De leur côté, si les humoristes féminines (lire page 41) sont aujourd’hui au sommet de leur art, il n’en reste pas moins qu’elles sont jugées trop girly et rarement invitées seules sur les plateaux de télé ou les tremplins des festivals. Enfin, que dire des artistes (peintres, sculptrices), qui n’ont toujours pas voix au (même) chapitre que les hommes dès qu’il s’agit de pouvoir exposer leurs œuvres (lire page 49). Les exemples sont nombreux et laissent un peu perplexe quant à la faculté d’exister en milieu hostile… ou du moins peu concerné.
Alors fini les bonnes élèves ? Les muettes comme des carpes ? Les sages comme des images ? Le temps est venu pour les jeunes femmes d’aujourd’hui (grâce au chemin parcouru par leurs aînées aussi) de s’affirmer comme femmes, genrées, a-genrées, no gender, qu’importe. D’être elles-mêmes sans devoir sans cesse s’imposer. De répandre peu à peu grâce à l’art, à la communication, au cinéma, à la culture en règle générale, aux médecins, aux associations… la meilleure façon de marcher. Même si en 2019 – et ce n’est qu’un terrible exemple –, ce sont encore plus de trois millions de petites filles en Afrique qui courent le risque de subir une excision chaque année, comme le révélait en novembre 2018 une étude menée par l’Unicef. Un chiffre sans doute en dessous de la réalité, puisque les familles victimes ne déclarent pas cette mutilation génitale traumatisante et contre-nature, tant sur le plan physique que psychologique, aux instances médicales.
Alors, oui, à l’heure où il n’est plus question de fermer les yeux, de se taire ou de faire semblant, les femmes sont vouées à être toujours plus « crazy », comme le raconte Serena Williams dans ce film déjà mythique Dream Crazier. « Nous sommes folles de vouloir si fort quelque chose, jusqu’au moment ou nous y parvenons. » À la folie. Donc.
Aujourd’hui
encore les
jeunes filles
doivent se
battre pour
faire de la boxe,
en attendant
« de faire un
vrai métier »,
comme le leur
disent leurs
parents.
Mutiques et aliénées
Et ce manifeste de l’agence américaine Chiat Day lancé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes résume à lui seul la condition féminine depuis que le monde est monde. Elles doivent tenir leur langue, ou se taire, demeurer sous le joug de l’homme, ou obéir à une image qui selon les époques varie. Enfin… pas tant que cela. Femme, ouvrez la bouche en place publique au Moyen Âge et vous êtes une sorcière qu’il faut brûler ; soyez artiste, musicienne au xixe siècle, et vous êtes une malade mentale qu’il convient d’interner ; soyez veuve et sans ressources, vous atterrissez à l’hôpital de la Salpêtrière ; ayez des symptômes dépressifs et c’en est fini de votre sexualité. C’est ainsi.
« Cette culture de la folie est reliée aux rôles de genre, aux conditions sociales et à une conception beaucoup plus large du désordre. D’un point de vue culturel, la folie dépend également d’une association toute faite entre nature et féminité. Si, dans notre système symbolique, les hommes sont culturellement associés à la raison, à l’esprit scientifique et à la logique, les femmes sont plutôt liées à l’émotif, au chaos, au désordre des sens. Dans cette lignée, le concept de folie échoue donc tout naturellement (ou plutôt tout “culturellement”) aux femmes », comme l’explique l’Américaine écrivaine féministe Elaine Showalter dans The Madness Malady, ouvrage publié en 1985 qui étudie l’étroitesse du lien entre genre et folie au cœur de l’Angleterre du xviiie siècle. Plus proche de nous, en France : « Chaque année, à l’hospice de la Salpêtrière, un bal est organisé le jour de la Mi-Carême pour la plus grande joie des pauvres folles, pensionnaires de cet établissement », écrivait Le Petit Parisien en ce 17 mars 1887, poursuivant quelques lignes plus loin, « quand on se rappelle que dans le même hospice de la Salpêtrière, où l’on dansait si joyeusement hier, les pauvres folles étaient encore il n’y a pas quatre-vingts ans enfermées à demi-nues, le corps chargé de chaînes et de carcans, dans des loges souterraines où “elles avaient souvent les pieds rongés par les rats” ou gelés “par le froid des hivers”, on songe non sans fierté au chemin parcouru, et l’on se dit que ni la science, ni la philanthropie, ni le progrès ne sont de vains mots… » Des internements continuels et sans réelle raison, si ce n’est la différence… Yannick Ripa, historienne française, relate dans L’Affaire Rouy. Une femme contre l’asile au xixe (éd. Tallandier, 2010), l’histoire de Hersilie Rouy, une musicienne internée arbitrairement en asile qui réussit à en sortir et se lança dès lors dans un combat contre les internements psychiatriques abusifs.

Folles et fières
Et, de fait, par une sorte de raccourci intellectuel, social et politique, les femmes sont ontologiquement folles… et représentent littéralement la déraison et le déséquilibre. Le bassin imaginaire de la folie est donc inévitablement genré : il s’oppose en négatif au rationnel masculin. Cette séparation symbolique entre les genres dépend essentiellement d’une conception culturelle du délire que représente le « caractère féminin » aux yeux de l’organisation patriarcale. Pour preuve ? Le lexique encore d’usage aujourd’hui : une femme « pique des crises de nerfs », « se fait tout un cinéma », est « folle à lier », hystérique, perd la tête ou la raison, « est une mégère », et « si énervée, c’est donc qu’elle a ses règles ». En un mot comme en cent, les femmes sont soumises à leurs hormones, et à leurs émotions.
Forts de ce constat, il nous suffit d’observer l’évolution de la société pour comprendre. Le milieu du sport en est l’un des meilleurs exemples. Aujourd’hui encore les jeunes filles doivent se battre pour faire de la boxe, du vélo, de la capoeira, « en attendant “de faire un vrai métier”, comme le leur disent leurs parents », explique Marie-Françoise Potereau directrice de Femix’Sports (lire page 113), « et c’est seulement en janvier 2013 qu’un guide juridique relatif à la prévention et lutte contre les incivilités, violences et discriminations dans le sport a été diffusé par le MSJEPVA aux acteurs du sport ». Autant dire hier. De leur côté, si les humoristes féminines (lire page 41) sont aujourd’hui au sommet de leur art, il n’en reste pas moins qu’elles sont jugées trop girly et rarement invitées seules sur les plateaux de télé ou les tremplins des festivals. Enfin, que dire des artistes (peintres, sculptrices), qui n’ont toujours pas voix au (même) chapitre que les hommes dès qu’il s’agit de pouvoir exposer leurs œuvres (lire page 49). Les exemples sont nombreux et laissent un peu perplexe quant à la faculté d’exister en milieu hostile… ou du moins peu concerné.
Il est temps
QU’ELLES répandENT
peu à peu grâce
à l’art, à la
communication,
au cinéma, à la
culture en
général, aux
médecins, aux
associations… la
meilleure façon
de marcher.
Alors fini les bonnes élèves ? Les muettes comme des carpes ? Les sages comme des images ? Le temps est venu pour les jeunes femmes d’aujourd’hui (grâce au chemin parcouru par leurs aînées aussi) de s’affirmer comme femmes, genrées, a-genrées, no gender, qu’importe. D’être elles-mêmes sans devoir sans cesse s’imposer. De répandre peu à peu grâce à l’art, à la communication, au cinéma, à la culture en règle générale, aux médecins, aux associations… la meilleure façon de marcher. Même si en 2019 – et ce n’est qu’un terrible exemple –, ce sont encore plus de trois millions de petites filles en Afrique qui courent le risque de subir une excision chaque année, comme le révélait en novembre 2018 une étude menée par l’Unicef. Un chiffre sans doute en dessous de la réalité, puisque les familles victimes ne déclarent pas cette mutilation génitale traumatisante et contre-nature, tant sur le plan physique que psychologique, aux instances médicales.
Alors, oui, à l’heure où il n’est plus question de fermer les yeux, de se taire ou de faire semblant, les femmes sont vouées à être toujours plus « crazy », comme le raconte Serena Williams dans ce film déjà mythique Dream Crazier. « Nous sommes folles de vouloir si fort quelque chose, jusqu’au moment ou nous y parvenons. » À la folie. Donc.
Cristina Alonso
Rédactrice en chef
| SOMMAIRE |
| FERMER |
SOMMAIRE Articles gratuits
S'ABONNER À LA REVUE INFLUENCIA
Je peux accéder immédiatement à la revue digitale et recevrai mes revues papier par courrier.
Je pourrai accéder à la revue digitale après réception du paiement et recevrai mes revues papier par courrier.
NEWSLETTER INFLUENCIA
S'abonner à la newsletter INfluencia
CONSULTER LES REVUES INFLUENCIA
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI UN COMPTE (JE SUIS ABONNÉ.E OU J'AI ACHETÉ CE N°)
JE SOUHAITE M'ABONNER POUR 1 AN OU ACHETER UN/PLUSIEURS N° SPÉCIFIQUE.S DE LA REVUE
Accédez immédiatement à votre Revue en version digitale. Puis recevez la.les Revue(s) papier par courrier (en cas d'achat ou de souscription à l'offre complète Papier + Digital)
| JE ME CONNECTE OU M'ABONNE POUR ACCÉDER AUX CONTENUS | × |
J'AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE
E-mail
| JE M'ABONNE, ME REABONNE OU COMMANDE UN N° | × |
| JE CONSULTE GRATUITEMENT LA REVUE | × |