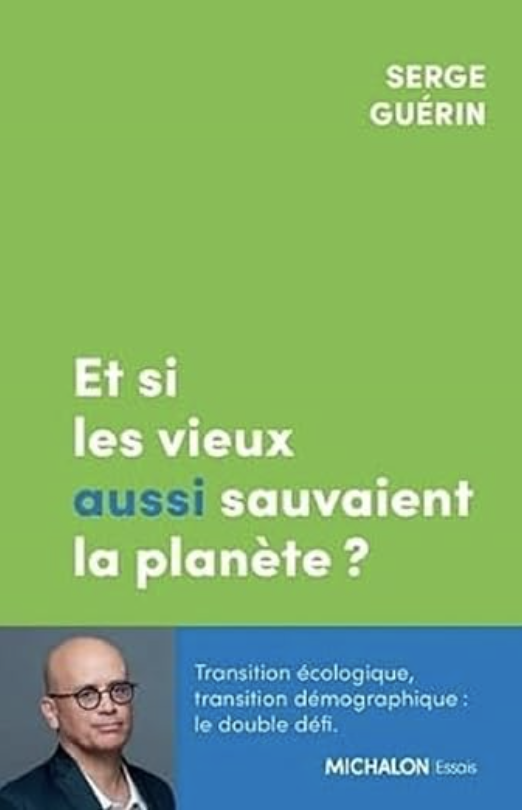INfluencia : vous avez une approche originale en voulant lier les enjeux écologiques et démographiques, d’où part votre réflexion ?
Serge Guérin. : on peut repartir du terme de « Transition » au sens de changement structurel des règles du jeu, des comportements et des imaginaires. Qu’il s’agisse de la question démographique ou de la dynamique écologique, les deux impliquent une transformation très profonde tant des comportements que de l’économie. Par ailleurs, on peut noter que dans les deux cas, il y a encore un déni de la société et des décideurs.
Et d’une certaine manière, face aux deux transitions, on assiste à un même refus de l’obstacle. Or, à mon sens, on ne fera face à ces deux transitions qu’en pensant « double transition » et dans une logique de coopération. Deux transitions c’est aussi deux chances pour répondre aux enjeux. En laissant l’idéologie de côté…
IN. : vous êtes aussi assez remonté contre le discours faisant des jeunes la « génération climat » et des seniors les « OK boomers » !
S.G. : c’est la question des représentations et des imaginaires moutonniers… Le développement d’un discours assez méprisant sur les seniors, accusés de ne rien faire pour le climat alors qu’ils porteraient la responsabilité de la situation est très largement partagé, y compris par des seniors ! En parallèle, le discours angélique sur la jeunesse, forcément consciente des enjeux et moteur des changement, est très présent. Le réel est bien plus compliqué. Il y a sur cette pseudo opposition le même placage d’une idéologie essentialiste très présente cherchant à imposer une unique grille de lecture sur l’ensemble des comportements, à enfermer chacun dans une identité, à développer une hémiplégie morale comme disait Ortega y Gasset. Or, nous sommes des animaux sociaux pluriels avec une diversité d’identités, de personnalités, et de parcours biographiques.
IN. : vous ne voyez pas de fracture entre les seniors et les jeunes sur les questions environnementales ?
S.G. : fondamentalement, non. Pas de guerre climatique des générations ! Bien sûr, les jeunes d’aujourd’hui sont beaucoup plus sensibles à la question du réchauffement climatique que ceux de 1950. Mais les anciens jeunes de 1950 ne sont pas moins conscients des enjeux. Les études le confirment : 74% des moins de 35 ans et autant des plus de 65 ans se disent inquiets des conséquences du dérèglement climatique pour la France (sondage Ipsos/ CESE octobre 2023). L’élément déterminant n’est pas l’âge mais le sexe : les femmes sont 80% à s’inquiéter contre 67% des hommes ! Il n’y a pas une génération de jeunes bénis des Dieux de l’écologie contre une génération des vieux pourris et défenseurs de la pollution.
Le sondage Taluna publié début 2024 pour la présentation du plan « La France s’adapte » signalait que 32% des 18-24 ans placent le changement climatique comme une préoccupation majeure, contre 45% des plus de 65 ans…
L’étude de Via Voice d’octobre 2023, montrait que chez ceux qui reconnaissent le dérèglement climatique, 44% estiment savoir ce qu’ils pourraient faire à leur niveau pour « lutter encore plus contre le dérèglement climatique ». Si 31% des plus de 65 ans sont de cet avis, les plus jeunes sont 64% à être convaincus de ce qu’il faut faire. Un écart de 33 points.
IN. : mais comment concrètement cette auto-satisfaction se traduit-elle ?
S.G. : un petit exemple, une étude de la Fondation Vinci, publiée en août 2023, montrait que 42% des moins de 35 ans déclarent jeter leurs déchets par la fenêtre de la voiture sur l’autoroute, contre 27% pour l’ensemble des Français.
Autre élément, que je reprends de l’ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle : l’empreinte écologique d’un jeune il y a cinquante ans était plus faible que celle d’un adolescent des années 2020. Faisons aussi le calcul du nombre de vols en avion déjà effectués par un jeune trentenaire par rapport à combien de fois en moyenne une octogénaire a pris l’avion dans sa vie…
IN. : mais au moins les plus jeunes sont les moins climatosceptiques ?
S.G. : pas nécessairement. La réalité, première, c’est qu’une part importante de la population – et une part qui augmente – récuse le fait du dérèglement climatique et nie le rôle des humains. Selon les études, c’est environ un quart de la population qui se place dans cette perspective. Et l’âge ne fait rien à l’affaire !
L’étude de Via Voice déjà évoquée, montre ainsi que si seulement 70% des Français estiment que le dérèglement climatique est un fait incontestable, ce score n’est que de 59% pour ceux qui ont niveau de formation inférieur au bac et 76% pour ceux qui disposent d’un niveau au-delà du bac. 17 points d’écart. De même si 10% de la population ne sait pas répondre à cette question, le chiffre passe de 5% dans les catégories supérieures à 15% chez les CSP-.
IN. : vous débutez votre livre par la notion de « Tragédie des horizons » ?
S.G. : oui, j’emprunte cette figure à Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre. En 2015, il avait utilisé ce terme au moment de la COP 15 pour dire la difficulté de demander des efforts tout de suite alors que les effets de l’inaction ne se verraient que plus tard. La prévention en santé pose le même problème. Dans les deux cas, la tentation est d’attendre et de remettre à plus tard les changements et actions. À cela s’ajoute, une peur que les « vieux » sclérosent le pays, soient des conservateurs attardés… Il y a la peur de vieillir et le déni des dérèglements climatiques. Or, dans les deux cas, on peut déjà agir à son niveau, faire de la prévention, changer certaines habitudes. Ce qui devrait d’ailleurs être plus facile à 20 ou 30 ans qu’à 70 ou 80 ans…
IN. : votre idée de convergence des deux transitions est stimulante, pouvez-vous donner un exemple concret ?
S.G. : si on adapte à la fois l’habitat au vieillissement, comme c’est le cas avec MaPrim’Adapt, et qu’en même temps on isole pour éviter les déperditions d’énergie, on traite les deux transitions. En limitant la vitesse en ville pour la sécurité des passants, notamment âgés, on agit sur la santé et on réduit le CO2. Quand on soutient les jardins collectifs, cela améliore le pouvoir d’achat des gens, embellit les lieux et, diminue les intrants agricoles…
IN. : aller vers une certaine sobriété : faire attention à l’eau, à l’électricité, à ces modes de transports, toutes les générations se sentent-elles concernées ?
S.G. : quand on demande aux gens s’ils sont prêts à réduire leur impact personnel sur la planète, la réponse est oui à 80%. Les moins de 35 ans disent oui à 83%, dont 32% très motivés. Chez les plus de 60 ans, c’est 82%, dont 34% très déterminés… Là aussi la différence n’est pas une affaire de générations, mais de sexe : 84% des femmes disent c’est important, contre 76% des hommes. Et également de milieux sociaux : plus la personne appartient à une catégorie socioprofessionnelle élevée, plus la conscience de son impact sur le climat est forte. Ce qui n’est pas nécessairement le gage d’un comportement vertueux…
Mais l’enjeu c’est de libérer le local pour favoriser les initiatives. C’est là où les gens vivent qu’ils peuvent se mobiliser le mieux concrètement et qu’ils ressentent les effets des décisions. Revivifier la démocratie par le local va de pair avec la réponse face aux deux transitions. C’est dans les lieux de vie de la ruralité que l’écologie est la plus vivante. Et vous imaginez le rural sans les vieux ? Qui ferait le boulot, qui serait élu, qui entretiendrait les espaces, qui ferait vivre le commerce de proximité, qui ferait du maraîchage ? Sortons d’un conflit entre générations, tout le monde est concerné. Il s’agit de s’unir face au défi !
En savoir plus
Sortons de l’opposition entre la « génération climat » et « OK boomers » : place à la réflexion et à l’action intergénérationnelles !
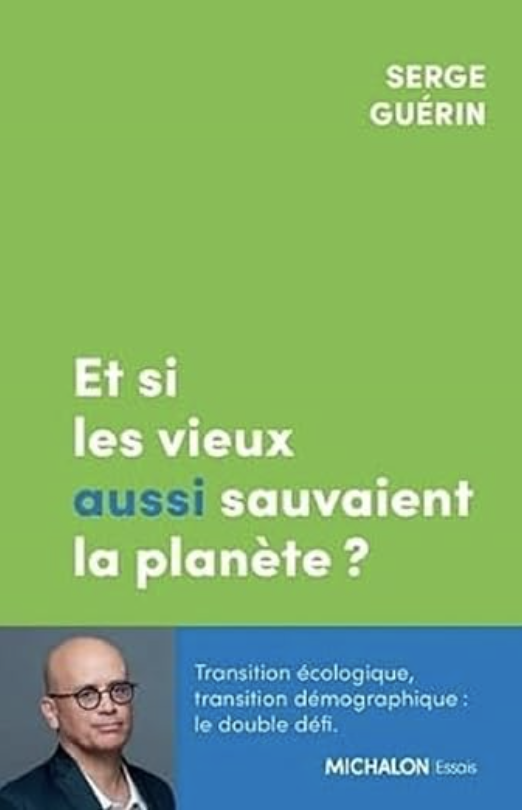
Face au réchauffement climatique et à l’inéluctable transition démographique qui nous attend, des changements d’imaginaires, de pratiques et de consommation s’imposent. Et comme le monde n’est pas si mal fait, les clefs des problèmes posés par ces deux défis se ressemblent et se complètent : réhabilitation des logements, revalorisation de l’échelle locale, emploi des seniors, soutien aux métiers du care, innovations sociales et intergénérationnelles, entraide de proximité sont quelques-unes des pistes qui permettent de penser ensemble une société de la longévité solidaire et durable.
Non sans humour, Serge Guérin plaide ici pour une véritable démocratie de coopération, pour enfin remettre le lien, la prévention et le désir au cœur des sociétés décarbonées de demain.