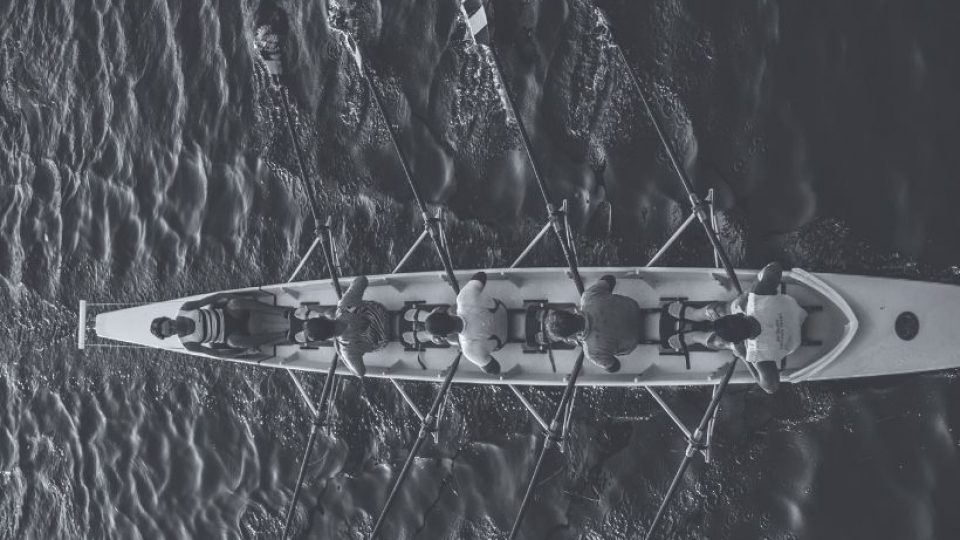C’est une question qui est aujourd’hui au cœur à la fois de la recherche en RSE, des efforts du législateur et des nouvelles pratiques des entreprises. On peut citer par exemple la « cour suprême » lancée fin 2020 par Facebook pour la modération des comptes, ou encore la création de la société à mission en France par la loi Pacte de 2019.
Cependant, cette question de la représentation de l’intérêt général dans la gouvernance des entreprises n’est pas totalement nouvelle.
De la corporation à la loi Pacte
Ainsi, jusqu’au milieu du XIXe siècle les régimes spéciaux d’incorporation aux États-Unis et en Angleterre ne sont accordés par le politique que pour des missions d’intérêt général, souvent sous forme de monopole. Ce régime s’accompagne en théorie d’un pouvoir de contrôle de l’État, mais celui-ci n’est pas ou peu exercé. Puis tout cela périclite, ce système étant critiqué pour son coût, son manque d’efficacité, et le clientélisme politique induit.
Le régime d’incorporation est alors ouvert, s’appliquant à toutes les entreprises, avec une interprétation progressive de l’intérêt de la société comme priorité donnée à la maximisation de la valeur actionnariale. En conséquence, la gouvernance actionnariale, dans les limites de la loi, s’impose comme équivalent de gouvernance indirecte pour l’intérêt général.
Puis les externalités négatives que ces entreprises génèrent, tels les dommages environnementaux ou sociaux, et les inévitables lacunes du droit, par exemple dans le domaine de la fiscalité, ont réactivé à partir des années 1990 l’idée d’une responsabilité sociale étendue de l’entreprise. Est ainsi remise sur la table la question de l’intérêt général, et de sa représentation dans l’entreprise.
Encore récemment, l’éviction d’Emmanuel Faber de la direction de Danone sous la pression de fonds activistes récemment entrés au capital, a marqué les esprits. L’ancien patron avait en effet fait de la RSE l’un des marqueurs de sa présidence, mais pour les actionnaires, qui avaient d’ailleurs approuvé que l’entreprise se dote du statut de société à mission quelques mois plus tôt, l’argument de la sous-performance du cours boursier par rapport à ses concurrents du secteur agroalimentaire l’emportait dans la décision.
Alors où en est-on, aujourd’hui, de la réflexion sur la représentation de l’intérêt général dans l’entreprise ? La première idée, c’est la piste traditionnelle de l’entreprise codéterminée, de représentation à 50 % des salariés dans les conseils de surveillance, lancée dans l’après-Seconde Guerre mondiale en Allemagne et étendue modestement ailleurs en Europe.
Ce système a toutefois montré certaines limites, comme l’a illustré le scandale du « dieselgate » chez le constructeur allemand Volkswagen qui a éclaté en 2015. Cette forme d’entreprise codéterminée n’a en effet pas permis d’éviter l’utilisation de logiciels frauduleux pour masquer une partie des émissions de particules lors des tests d’homologation. Indépendamment de cette affaire, les intérêts légitimes des salariés ne se confondent pas forcément avec l’intérêt général.
Mieux surveiller le respect de l’intérêt général
Quelles sont dès lors pistes alternatives ? Une semble aujourd’hui se dégager dans la mise en place de nouvelles formes de comités de surveillance.
Dans le prolongement des sociétés du type « société à mission » en France ou benefit corporation aux États-Unis, qui affichent un objectif de contribution sociale ou environnementale, il s’agit de créer des instances légitimes et efficaces, dotées des bons pouvoirs, pour contrôler cette mission. La société à mission comprend ainsi un comité de mission et un audit par des organismes tiers indépendants.
Certains chercheurs proposent de façon prospective des sortes de comités d’audits de citoyens, pour valider la mission de l’entreprise, et contrôler sa bonne réalisation. D’autres demandent en outre que le statut de public benefit corporation soit rendu obligatoire pour les grandes entreprises.
Pour le simple respect de l’intérêt général, par exemple éviter des externalités négatives, mes travaux de recherche explorent l’idée de ce que j’appelle une « cour constitutionnelle d’entreprise », ou un « conseil de surveillance représentatif de l’intérêt des citoyens » et de leurs droits fondamentaux. Ici, l’instance ne contrôle pas tant la bonne réalisation d’une mission sociale ou environnementale qu’elle ne vérifie que l’activité de l’entreprise n’enfreigne pas d’autres valeurs fondamentales de la société (par exemple, les droits de l’homme).
Dans ce sens, la « cour suprême » de Facebook constitue un conseil de surveillance composé de personnalités visibles politiques, du monde des ONG et du monde académique. Il joue un rôle de contrôle des décisions de Facebook en matière de publication de posts, au regard des exigences parfois en tension, de la liberté d’expression, de la stabilité politique de la démocratie américaine, et de divers droits, à la vie privée ou à la sécurité par exemple. Facebook, en tant que plate-forme, reste moins contraint par la loi qu’un éditeur traditionnel, et a ainsi décidé, sur ces questions, de s’en remettre à ce comité, qui par analogie avec une cour suprême, devrait avoir le dernier mot.
Cette tentative soulève cependant une nouvelle série de questionnements : quel est le pouvoir réel de cette cour au sein de Facebook ? Comment peut-elle traiter le volume de cas ? Comment comprendre cela au regard des révélations récentes par une lanceuse d’alerte sur la prise de conscience interne de l’impact négatif de Facebook sur l’intérêt général. Faut-il y voir la volonté de l’entreprise défausser de sa responsabilité ? Ou d’apporter effectivement une réponse légitime ?
Au-delà de ces questions, il s’agit de poser la question : ces instances de contrôle du type cour constitutionnelle d’entreprise sont-elles réellement légitimes ? Ce que peut dire le philosophe sur cette question toute récente, c’est qu’un libéral privilégiera sans doute une cour sur le modèle de Facebook, à savoir un comité d’expert s’assurant du respect de normes fondamentales. En revanche, un démocrate préférera peut-être des audits de parlementaires ou de jurys de citoyens.
C’est pour répondre à cette question de la légitimité que se poursuivent aujourd’hui nos recherches, dans le cadre, par exemple, d’un projet qui inclut un observatoire des sociétés à mission pour évaluer au mieux la mise en œuvre et les résultats dans ces entreprises.

Sandrine Blanc, Enseignante-chercheuse en Ethique des affaires et Responsabilité sociale de l’entreprise, INSEEC Grande École
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.