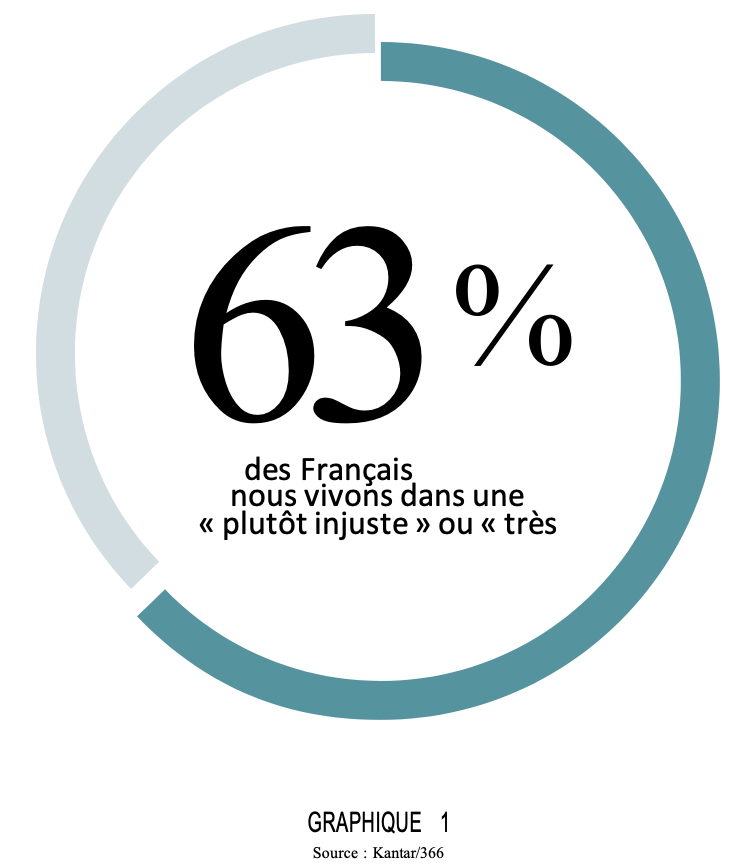Sommes-nous vraiment dans « l’après-crise » ? L’idée s’installe que le fameux monde d’après, dont nous avons tous évoqué l’avènement, serait, finalement, un monde de bouleversements enchaînés.
Le pays est fatigué et, globalement, insatisfait et méfiant. Autant que la lassitude, le sentiment de vivre dans une société injuste domine (63 % des Français estiment que nous vivons dans une société « plutôt injuste » ou « très injuste »). (graphique 1). La confiance dans « l’autre » reste faible (près de 70 % de nos concitoyens considèrent « qu’on n’est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres » – Kantar/366, 2022), et les perspectives d’avenir inspirent peu d’optimisme.
Bien sûr, tout cela n’est pas absolument inédit. Le pessimisme et le mécontentement s’aggravent néanmoins et viennent se nourrir d’inquiétudes plus nouvelles et plus prégnantes. Nul ou presque ne semble pouvoir faire totalement abstraction des signaux d’alerte qui se multiplient et se répondent. Justice, école, police, hôpital, pompiers, prise en charge de la petite enfance ou du grand âge, retraites : toutes ces institutions semblent à bout de souffle et, si la nécessité du changement est claire, aucun consensus ne se dessine quant à la nature de celui-ci, à son urgence, voire à son ampleur.
Trois sujets arrivent, cependant, en tête des préoccupations : pouvoir d’achat, santé et changement climatique. Les plus jeunes considèrent ce dernier enjeu comme le plus important quand les plus âgés se disent d’abord inquiets de leur situation matérielle personnelle immédiate.
Cette opposition perçue (pour reprendre une expression devenue courante) entre « la fin du monde et la fin du mois » illustre bien le faisceau d’injonctions paradoxales dans lequel nous sommes pris.
Cette somme de contradictions quotidiennes laisse bien souvent un sentiment d’impuissance, de fatigue. Elle pousse aussi au questionnement de notre système actuel puisqu’il semble échouer à rassurer à la fois sur le bien-être immédiat, individuel et collectif, et sur l’avenir, celui des Français, de leurs enfants, mais aussi celui du pays et de la planète.
Les discours alarmistes s’accumulent. De l’extrême droite à l’extrême gauche, des plus libéraux aux plus décroissants, tous s’accordent sur une chose : ça ne va pas. Ceci posé, ni les diagnostics ni les propositions ne convergent. Et, pourtant, il faut tenter de se projeter dans l’avenir.
Chacun, dans chaque domaine de sa vie, arbitre donc comme il peut entre le présent et le futur, son intérêt personnel et celui du pays ou de la planète. Nous multiplions les stratégies d’adaptation privilégiant, selon nos situations, nos besoins, nos moyens, nos croyances, l’une ou l’autre de ces dimensions : notre satisfaction immédiate ou notre conscience d’enjeux plus collectifs et/ou plus lointains.
Un exemple simple, celui de l’achat d’un tee-shirt, peut illustrer ce propos. Le textile est, on le sait, l’une des industries régulièrement mises en cause sur tous les axes du développement durable. Son empreinte écologique est questionnée, sa consommation est jugée excessive – notamment du fait de la faible durée de vie d’un certain nombre de produits – et ses modes de production sont parfois iniques (on peut penser au drame du Rana Plaza en 2013 ou à la façon dont certaines marques sont accusées de tirer parti de l’exploitation des Ouïghours).
La plupart des entreprises du secteur ont d’ailleurs engagé des transformations pour s’améliorer sur tous les aspects du développe- ment durable, espérant notamment satisfaire aux exigences de la jeune génération.
Pour autant, le plus grand succès de ces dernières années est celui de Shein, une marque chinoise d’« ultra fast fashion », qui met chaque mois sur le marché 10 000 nouveaux produits (soit autant que Zara en un an) et a réalisé, en 2020, plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
Sur l’appli de Shein, un tee-shirt basique est vendu entre 4 et 5 euros et est disponible immédiatement. Peut-être est-il produit par des travailleurs sous-payés, de l’autre côté de la planète, sans doute ne durera-t-il pas long- temps, mais il répond à un besoin immédiat et personnel : s’habiller mode à tout petit budget. À l’autre bout du spectre, il y a la seconde main, vertueuse et bon marché mais moins simple, ou le produit « clean » (traçable, éthique), vendu entre 30 et 40 euros. Si l’on ajoute à cet éventail le vêtement de marque, qui procède d’un autre système de valeurs, l’éventail s’ouvre encore. L’achat d’un simple tee-shirt peut donc faire l’objet d’arbitrages complexes mettant en jeu les besoins, les moyens, l’envie de paraître, d’affirmer son appartenance à un groupe ou sa singularité (motivations classiques), mais aussi le niveau de conscience de chacun de l’impact social, économique ou écologique de son choix.
Qu’il s’agisse de voter, de choisir un travail ou un lieu de vie, un mode de transport, un loisir ou un aliment, voire simplement d’exprimer une opinion, tout peut désormais exposer à ces dilemmes.
Et, tous, nous développons des stratégies plus ou moins sophistiquées pour équilibrer notre balance jouissance/conscience.
Les manifestants de 68 voulaient « jouir sans entrave ». Cela semble bien loin aujourd’hui alors que nous semblons vivre la fin de l’insou- ciance et craignons d’être voués à faire des choix sous contraintes, optimisés mais jamais complètement satisfaisants.
Être un individu « conscient » (pour ne pas dire « woke ») ne signifie cependant pas savoir quoi faire, pouvoir le faire et encore moins vouloir le faire.
Les informations sont parfois lacunaires, contre-intuitives, dérangeantes, voire contra- dictoires. Le kilo de tomates de plein champ venues d’Espagne affiche un bilan carbone inférieur à celui cultivé en France, mais sous serre. Le coût écologique complet d’un véhicule hybride est peut-être supérieur à celui d’une voiture conventionnelle. Est-ce qu’Amazon crée ou détruit des emplois en France ? Comment savoir, alors, ce qui est « bon » ? À qui, à quoi se fier, dans la multiplicité des paroles, des sources et des labels ? Certains deviennent des consommateurs d’info compulsifs, d’autres, au contraire, ne veulent plus rien savoir de sujets trop complexes ou trop angoissants.
Le manque de moyens ou d’alternatives est sans doute le frein le plus fréquent : abandonner la voiture suppose l’accès à un transport public. Acheter « durable » impose, le plus souvent, un surcoût immédiat inenvisageable pour nombre de ménages, même si cela constitue une économie à moyen ou long terme. Payer « le prix de la liberté » en assumant les conséquences matérielles de la guerre en Ukraine n’est tout simplement pas envi sageable pour une part de la population.
Quant à la volonté, au désir de prendre en compte dans ses arbitrages d’autres paramètres que le bénéfice immédiat et personnel, ils sont éminemment variables d’un individu à l’autre et d’un moment ou d’un type de décision à l’autre.
À cela, plusieurs raisons.
Le primat du plaisir, d’abord : celui de voyager, de céder à une impulsion, de rester fidèle à des marques ou à des produits que l’on apprécie. De conserver, dans ses mœurs ou son mode de vie, des marqueurs d’un monde auquel on est attaché. Privilégier la jouissance est simplement humain.
L’effort, ensuite. Celui de changer, de se contraindre à la sobriété, de faire attention à de plus en plus de choses à chaque décision, d’intégrer des effets à long terme… Un effort d’autant plus compliqué à consentir qu’il peut paraître dérisoire ou injustement réparti.
Ainsi, une étude internationale (Groupe BVA pour le BCG, octobre 2021), réalisée en amont de la COP26 de Glasgow, mettait clairement en exergue un certain nombre de paradoxes.
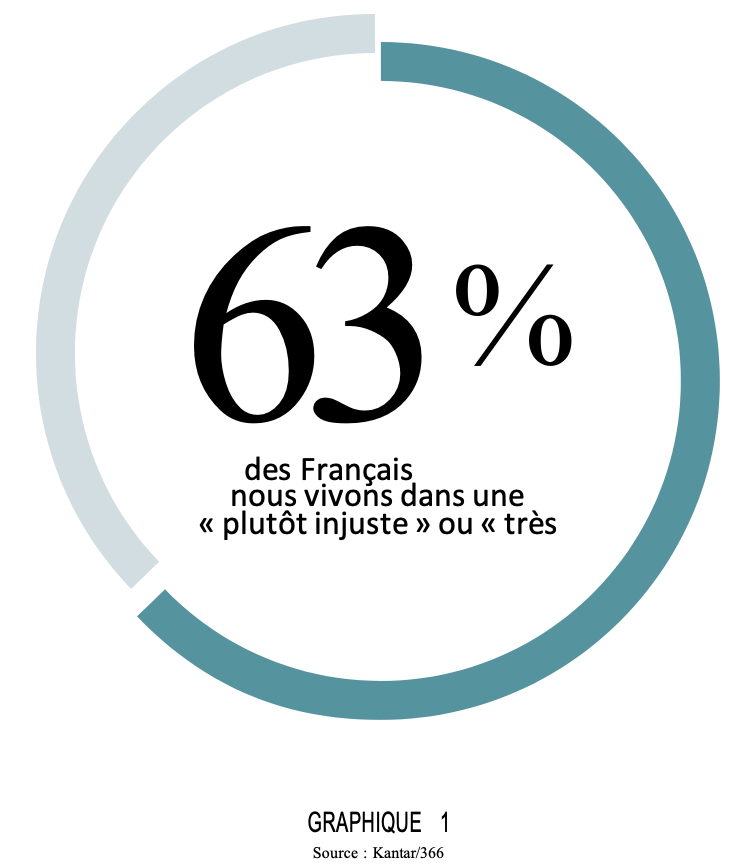
Si la majorité des Français se dit concernée par le changement climatique, seuls 23 % d’entre eux se déclarent « motivés » à agir. Et si le surcoût des actions proposées est parfois un frein, c’est surtout l’absence d’im- pact perçu (52 %) des initiatives individuelles et le sentiment (78 %) que c’est d’abord aux grandes entreprises et aux grandes nations de faire l’effort qui semblent décourager l’adoption de certaines pratiques.
À qui revient la charge du changement ? À quoi sert de baisser le chauffage si les jets privés circulent ? Pourquoi serait-ce à moi de corriger les défauts éventuels de nos modes d’organisation et de production ? Pourquoi cela n’incombe-t-il pas d’abord à plus riche ou plus puissant que moi ?
Les colibris – pour reprendre la métaphore chère à Pierre Rabhi – sont fatigués. Ils ont de plus en plus de mal à se convaincre de l’effet de leurs efforts. Et, méfiance et sentiment d’in- justice aidant, ils sont de plus en plus enclins à trouver des raisons de demander à d’autres ou de remettre à plus tard la résolution de dysfonctionnements dont ils s’estiment souvent les premières victimes.
Nos inquiétudes, nos colères, nos désirs, nos convictions ou nos croyances, voilà donc ce que nous mobilisons pour élaborer nos stratégies quotidiennes d’adaptation, et parvenir à agir dans une complexité parfois vertigineuse.
Ce sont la fragmentation et la variabilité de nos arbitrages qui donnent à la France ce caractère kaléidoscopique que nous décrivions plus haut, et qui nous paraît une représentation nouvelle et plus pertinente de la société française que les désormais classiques théories de l’émiettement du pays. La France est infiniment mouvante, et aucune métaphore figée, géographique, ne saurait rendre compte de ses aspects changeants.
Très schématiquement, on pourrait représen- ter sur deux axes l’ensemble des postures que chacun adopte, tour à tour, ou selon les sujets.
Bien rares sont les individus qui répondent avec une constance et une cohérence sans faille à l’ensemble des questions auxquelles les soumet le quotidien. Chacun fait comme il peut, comme il croit.
Les motivations sont multiples : on peut être un végétarien convaincu pour des raisons de santé, d’économie, de rejet de la souffrance animale ou par conviction écologique. Ou pour un mélange de tout cela. Rien ne permet donc d’établir une relation de cause à effet, par exemple, entre un régime alimentaire, un choix de loisirs et une proximité politique. Végétarien et climatosceptique, ou convaincu que le progrès technologique apportera réponse à tout : tout est possible, et c’est ce qui rend, pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises, le décryptage du pays si crucial et si complexe.
On peut donc tenter de proposer une cartogra- phie de ce que nous avons appelé « stratégies d’adaptation ». Il ne s’agit nullement, on l’aura compris, d’une typologie des Français. Cette cartographie n’est ni exhaustive ni définitive, mais elle permet de visualiser un certain nombre des tendances à l’œuvre dans la société fran- çaise, face à la nécessité de trouver une voie dans le jeu des tensions et des contradictions auxquelles nous sommes exposés.
La vision kaléidoscopique de notre société a ceci de caractéristique qu’elle figure la possi- bilité pour un individu d’être hédoniste pour sa consommation personnelle, écologiste pour l’équipement de son foyer et tout en même temps réactionnaire vis-à-vis de la technologie. À la manière des grains du kaléidoscope, les Français composent et organisent des figures dissemblables suivant les secteurs de consommation et d’intérêt.
Il s’agit maintenant de comprendre comment ces postures, ces tensions, se traduisent dans un ensemble de domaines – travail, alimen- tation, loisirs, mobilité, habitat, citoyenneté, médias… – et de constater la créativité dont font preuve les Français à tous les échelons de la société.
Il s’agit, enfin, d’aider les marques à s’adresser à ces Français méfiants, fatigués mais créatifs et dont l’appétit de solutions est immense. Cette période de refondation est aussi fertile que riche de défis.
Il s’agit aussi de comprendre ce qui, de façon très transversale, peut aujourd’hui et demain faire consensus, faire mouvement et corps pour toutes les générations.
C’est l’objet de cette nouvelle édition de Françaises, Français, etc., sous-titrée « Le kaléidoscope ».